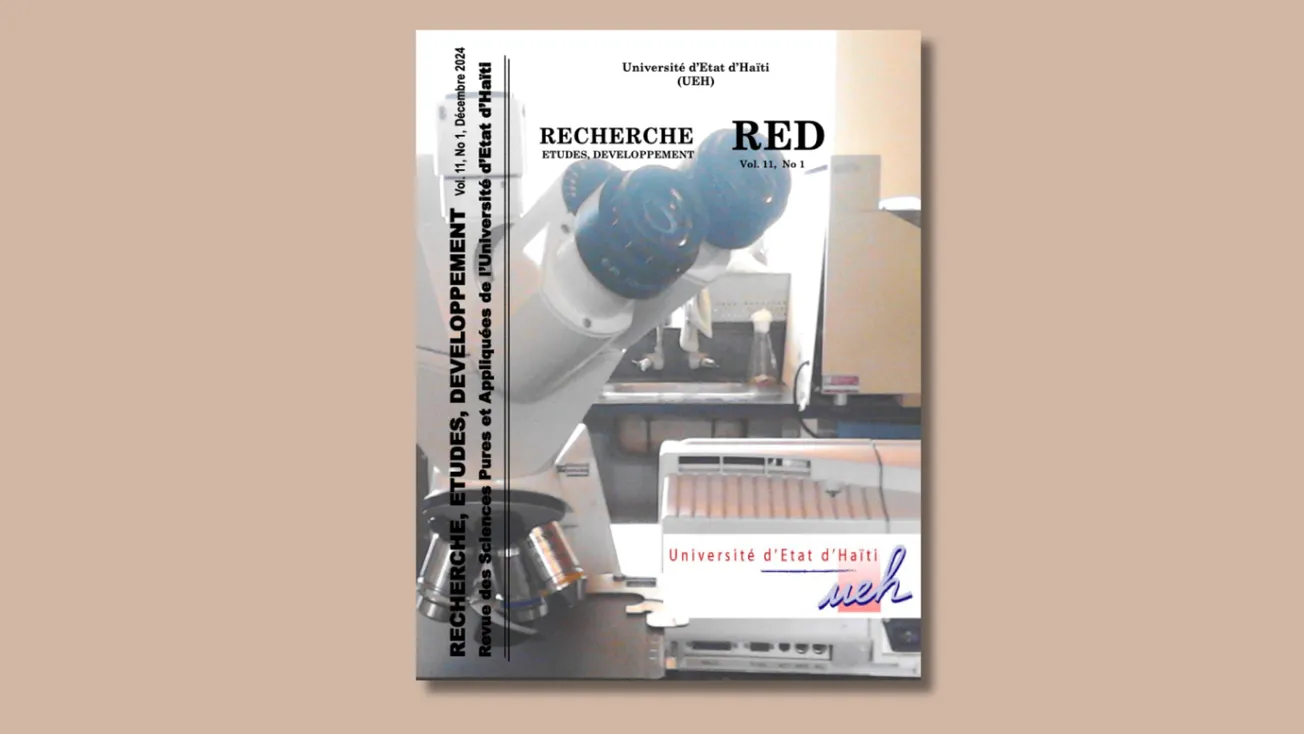Table des matières
L’antiféminisme est un mouvement d’opposition aux idées et aux actions féministes. Il ne se limite pas à une simple divergence idéologique : il reflète une peur plus profonde et viscérale de la dévirilisation, où la masculinité est perçue comme menacée par l’émancipation des femmes et la redéfinition des rôles de genre. Christine Bard, Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (2019) définissent l’antiféminisme comme « un mouvement d’opposition au féminisme, qui s’en prend au féminisme comme mouvement social et aux féministes comme porteuses de ce mouvement ». Cette opposition, loin d’être nouvelle, s’observe depuis les premiers mouvements féministes du XIXe siècle, où les revendications pour l’égalité des droits étaient perçues comme « une menace à l’ordre patriarcal établi » (Bard, 1999). À cette époque, les arguments antiféministes étaient souvent enracinés dans des croyances religieuses et des conceptions traditionnelles de la famille. En effet, « la menace de la féminisation de la société est une idée ancienne que les hommes ramènent chaque fois qu’ils se sentent menacés par les initiatives féminines » (ibid.).
Mais s’agit-il vraiment d’une simple opposition idéologique, ou révèle-t-elle une crainte plus profonde de la dévirilisation dans le contexte haïtien ? Comment les plateformes numériques, en tant qu’espaces de (re)production discursive, renforcent-elles, diffusent-elles et parfois légitiment-elles ces discours antiféministes ? Il devient alors essentiel d’interroger les logiques de pouvoir, de genre et de résistance à l’œuvre, afin de mieux comprendre les formes contemporaines de l’antiféminisme et les mécanismes par lesquels il s’adapte, se transforme et se banalise dans l’espace public.
En Haïti, l’antiféminisme s’inscrit dans un contexte marqué par des inégalités structurelles et une forte adhésion aux normes de genre traditionnelles. Les résistances aux luttes féministes y sont amplifiées par la culture populaire, les discours religieux conservateurs et, de plus en plus, par les réseaux sociaux. Ces derniers constituent une arène où les tensions autour du genre se cristallisent. Si les militantes féministes y trouvent un espace de sensibilisation et de mobilisation, elles y subissent également une hostilité croissante (Olibrice, 2024).
Les féministes haïtiennes ont construit leur mouvement dans la lutte, la consistance, la révolte, mais aussi dans l’espoir et la solidarité. Face à l’oppression systémique, à l’instabilité politique et aux violences multiples, elles ont su créer des espaces de résistance, d’expression et de transformation sociale. « Le féminisme haïtien n’est pas construit à partir de théories, mais s’est forgé à l’adhésion à des valeurs : liberté, égalité, autonomie, inclusion, justice sociale, participation, souveraineté. » (Magloire, 2018) Portées par une vision d’émancipation et de justice, elles ont inscrit leur combat dans une dynamique ancrée dans la réalité haïtienne, en articulant les enjeux de genre avec ceux de classe, de race et de souveraineté nationale. Leur engagement continue d’inspirer une nouvelle génération qui refuse le silence et réclame une société plus équitable pour toutes et tous.
Cependant, ces dernières années, la prolifération des réseaux sociaux s’est accompagnée d’une montée du masculinisme, un « mouvement social qui défend la domination des hommes sur les femmes, en partant du principe que le féminisme serait une menace pour la société contemporaine » (Ferrari, 2023). Dans ce contexte, l’antiféminisme s’est imposé comme un outil de lutte numérique, utilisé pour discréditer les droits des femmes et attaquer les mouvements féministes.
Les réseaux sociaux : une arme antiféministe en Haïti
Les plateformes numériques sont devenues un terreau fertile pour l’antiféminisme. On y observe une prolifération de discours qui banalisent ou attaquent les revendications féministes, souvent sous couvert de la « défense des valeurs traditionnelles ». Ce phénomène est loin d’être anodin : comme le souligne Sabine Lamour (2018), les attaques antiféministes visent à disqualifier et à rendre inaudibles les voix féministes, en les accusant d’exagération ou de haine envers les hommes.
En Haïti, cette dynamique est particulièrement visible sur des pages et groupes Facebook, ainsi que sur les plateformes X et TikTok, où des figures publiques, des influenceur·euse·s et même des anonymes se mobilisent contre le féminisme. Les discours antiféministes y prennent plusieurs formes :
- La ridiculisation des revendications féministes : les militantes sont souvent caricaturées comme des femmes frustrées ou aliénées par des idéologies occidentales.
- Le détournement du discours féministe : certain·e·s affirment que l’égalité entre les sexes serait déjà atteinte et que le féminisme chercherait désormais à dominer les hommes.
- La défense des rôles de genre traditionnels : l’idée selon laquelle les femmes doivent rester « soumises et respectueuses » de l’autorité masculine y est régulièrement affirmée.
Ces stratégies ne visent pas uniquement à rejeter les revendications féministes, mais à réaffirmer une hiérarchie de genre considérée comme « naturelle » et « légitime ». Cette crainte de voir remis en question les rôles genrés établis se manifeste à travers ce que Diane Lamoureux et Francis Dupuis-Déri (2015) appellent une « rhétorique d’intimidation », destinée à faire taire, voire à menacer, celles et ceux qui dénoncent les plaintes sexistes et les logiques patriarcales de l’antiféminisme. Anne-Sarah Bouglé-Moalic (2025) interprète cette vague de haine comme « une idéologie réactionnaire » fondée sur l’idée que toute évolution sociale serait une forme de dégénérescence.
L’émergence des « femmes pick-me » sur les réseaux sociaux
L’antiféminisme a traversé les époques en s’adaptant aux contextes socioculturels spécifiques. En Haïti, il prend des formes particulières, notamment à travers l’émergence de nouvelles expressions de résistance sur les plateformes numériques. Parmi ces dynamiques contemporaines, le rôle joué par certaines femmes qui s’opposent elles-mêmes aux revendications féministes mérite une attention particulière, afin de mieux comprendre les résistances actuelles à l’égalité des genres dans le pays.
Le terme « pick-me girl » est apparu en 2005 dans un épisode de Grey’s Anatomy, lorsque Meredith Grey (interprétée par Ellen Pompeo) supplie Derek Shepherd (Patrick Dempsey) de la choisir plutôt que son épouse : « Pick me. Choose me. Love me. » (CNN, 2023). En 2016, ce thème a refait surface sur les réseaux sociaux, notamment sur X (anciennement Twitter), avec le hashtag #PickMeGirl, qui a généré plus de 3,4 milliards de vues. Ce mot-clic sert à ridiculiser les femmes qui cherchent à se distinguer des autres en adoptant des attitudes, des discours ou des prises de position les présentant comme supérieures, souvent dans le but explicite de plaire aux hommes. Francine Descarries (2005) utilise l’expression « antiféminisme ordinaire » pour désigner :
« les discours et les pratiques qui, sans nécessairement recourir à des interprétations fallacieuses, extrémistes ou moralisantes, s’opposent, implicitement ou explicitement, aux projets portés par le féminisme et font obstacle aux avancées des femmes dans les différents domaines de la vie sociale, ces avancées vers l’égalité étant perçues comme menaçantes pour un ordre social dont l’équilibre est fondé sur la hiérarchie sexuelle et la domination masculine. » (Descarries, 2005, p. 142-143)
Cette forme d’opposition subtile s’est fortement répandue ces dernières années sur les réseaux sociaux, impliquant particulièrement les jeunes publics, notamment les filles.
En Haïti, les « femmes pick-me » se distinguent sur des plateformes comme X, Facebook et Instagram. Elles adoptent des comportements visant à se différencier des autres femmes afin d’obtenir l’approbation masculine. Dans Ces femmes antifemmes (2017), Bertrand Matot estime que ce mépris affiché par certaines femmes envers leur propre sexe s’explique par deux facteurs : d’une part, un esprit d’intimidation ; d’autre part, un besoin de flatter l’homme, de se rendre attendrissante et séduisante.
D’autres autrices, comme Danièle Magloire, interprètent cette désolidarisation féminine à travers une grille plus complexe :
« La socialisation, l’aliénation, l’ignorance des termes de la problématique des rapports sociaux de sexe et de l’histoire des luttes, la crainte des sanctions sociales, le marchandage avec le patriarcat (être bien vue des hommes, préserver sa féminité à leurs yeux) conduisent nombre de femmes à vouloir se démarquer à tout prix du féminisme, alors même que le mouvement ne pratique aucune forme de prosélytisme. » (Magloire, 2017, p. 207)
Ces attitudes incluent fréquemment la critique des mouvements féministes, la valorisation des rôles traditionnels assignés aux femmes, ainsi que la dévalorisation des initiatives visant à promouvoir l’égalité des genres. En se positionnant comme « différentes » ou « meilleures » que les autres femmes, ces actrices cherchent à se conformer aux attentes masculines dominantes, renforçant ainsi les stéréotypes de genre existants. En consolidant les normes traditionnelles, elles participent au maintien des inégalités et restreignent les opportunités offertes aux femmes, notamment dans les sphères professionnelle et politique. Leur discours engendre également des divisions au sein du mouvement féministe, affaiblissant les dynamiques collectives de lutte pour l’égalité des droits. Par ailleurs, leur influence sur les jeunes générations, particulièrement présentes sur les réseaux sociaux, peut favoriser l’intériorisation de normes sexistes et la reproduction de comportements discriminatoires.
Toutefois, une question essentielle demeure : faut-il blâmer ces femmes, souvent elles-mêmes produits — voire victimes — du système patriarcal qu’elles contribuent à perpétuer ? Leur adhésion à ces normes sexistes peut difficilement être interprétée comme un choix totalement libre ; elle apparaît plutôt comme le résultat d’une socialisation profondément imprégnée par la domination masculine. Dès lors, plutôt que de les stigmatiser, il s’agit de comprendre les mécanismes sociaux, culturels et symboliques qui les façonnent, tout en poursuivant l’analyse critique des discours qu’elles véhiculent. L’enjeu n’est pas de creuser les fractures, mais de bâtir des passerelles permettant de sensibiliser, d’éduquer et de promouvoir un féminisme inclusif, capable d’embrasser la complexité et la diversité des trajectoires féminines.
Peur de la dévirilisation et conservatisme religieux
L’une des causes sous-jacentes de l’opposition au mouvement féministe réside dans la peur de la dévirilisation. Dans une société où la masculinité se construit autour des notions de domination et de force, les avancées féministes sont souvent perçues comme une menace directe à l’identité masculine. Cette anxiété se manifeste de manière particulièrement aiguë en Haïti, où l’Église et d’autres institutions religieuses exercent une influence déterminante sur les normes de genre.
Le discours religieux antiféministe s’appuie sur l’interprétation de textes sacrés pour justifier la soumission des femmes et condamner les initiatives en faveur de l’égalité. Dans ce cadre, toute revendication féministe est assimilée à une atteinte à la stabilité de la famille et aux « bonnes mœurs ». Cette instrumentalisation de la religion pour s’opposer aux droits des femmes n’est pas propre à Haïti, mais elle y trouve un écho particulièrement fort en raison du poids considérable des croyances dans la vie quotidienne, sociale et politique.
Le backlash antiféministe : une menace pour les acquis
Dans leur texte « Vers une théorie du backlash : la résistance dynamique et le rôle fondamental du pouvoir », Mansbridge et Shames (2012) analysent la notion de backlash antiféministe à partir de trois éléments clés : il s’agit d’une réaction, il comporte une dimension coercitive, et il est exercé par des individus ou des groupes sociaux qui perçoivent l’émancipation des femmes comme une menace pour leurs privilèges établis. Ainsi, le backlash antiféministe peut être défini comme un mouvement réactif mené par des groupes dominants cherchant à préserver leurs avantages sociaux.
En Haïti, l’antiféminisme ne se limite pas à des discours : il se manifeste également à travers des résistances concrètes aux politiques de protection des femmes. Toute tentative de remise en question des normes de genre ou de plaidoyer en faveur de la réappropriation des corps féminins est fréquemment interprétée comme une attaque contre les hommes, voire comme une atteinte aux mœurs, et suscite une opposition virulente. Les féministes haïtiennes sont régulièrement la cible de campagnes de dénigrement et d’intimidation, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans l’espace public. Leur engagement en faveur des droits des femmes et de l’égalité des genres dérange profondément, et elles sont confrontées à une hostilité persistante.
Dans les médias, les sphères politiques, les espaces communautaires ou les plateformes numériques, elles sont souvent affublées de qualificatifs péjoratifs tels que « frustrées », « aliénées », « femmes sans hommes » ou encore « contre la culture haïtienne ». Ces attaques, loin d’être anecdotiques, participent d’une stratégie plus vaste de délégitimation de leurs luttes et de silenciation de leurs voix. En les réduisant à des stéréotypes et en remettant en question leur moralité, les antiféministes cherchent à détourner l’attention des revendications portées par ces militantes et à entretenir un climat de peur et de stigmatisation autour du féminisme.
Cette violence symbolique et psychologique s’ajoute aux nombreux obstacles structurels déjà présents, rendant leur engagement d’autant plus courageux et résilient. Le backlash antiféministe reflète une volonté de préserver un ordre patriarcal dans lequel les femmes demeurent subordonnées aux hommes. En Haïti, cette réalité reste criante : les violences basées sur le genre sont omniprésentes, les femmes sont sous-représentées en politique, et l’accès à la justice pour les survivantes de violences reste limité.
Paradoxalement, nombreuses sont les femmes qui, tout en défendant les droits des femmes, en réclamant davantage d’égalité et en dénonçant les injustices sexistes, refusent de se dire féministes. Ce rejet s’explique souvent par la forte stigmatisation associée au mot « féminisme », perçu comme radical, trop militant, voire étranger à la culture haïtienne. Craignant les jugements, le rejet social ou l’isolement, certaines préfèrent des formulations plus neutres telles que « défenseure des droits des femmes », « activiste pour l’égalité » ou, tout simplement, « citoyenne engagée ».
Ce positionnement révèle à quel point le terme féminisme demeure politiquement et symboliquement chargé. Il témoigne aussi d’un décalage entre des idées féministes — largement partagées par ces femmes — et l’identité féministe qu’elles refusent d’assumer. Cela montre que l’engagement pour l’égalité ne passe pas nécessairement par l’adhésion explicite à une étiquette : il peut s’incarner dans des pratiques concrètes, des valeurs partagées et des luttes vécues.
Conclusion : déconstruire l’antiféminisme pour une société plus juste
L’antiféminisme en Haïti, bien qu’alimenté par des peurs et des croyances profondément enracinées, ne doit pas être perçu comme une fatalité. Les luttes féministes poursuivent leur chemin, et les réseaux sociaux, malgré leur potentiel de hostilité, constituent également des espaces de sensibilisation, de mobilisation et de déconstruction des stéréotypes de genre.
Comprendre ces résistances, notamment la peur de la dévirilisation et l’influence persistante des discours conservateurs, est essentiel pour concevoir des stratégies efficaces de lutte contre l’antiféminisme. Comme le souligne Christine Bard (1999), les oppositions au féminisme évoluent avec le temps, mais s’appuient toujours sur les mêmes fondements : la défense d’un ordre social inégalitaire, dissimulée derrière les valeurs de tradition et de moralité.
Pour contrer les effets délétères de l’antiféminisme et construire une société plus égalitaire, il est crucial de promouvoir un dialogue ouvert sur les masculinités, de valoriser des modèles de masculinité non toxiques et de renforcer l’éducation à l’égalité de genre. C’est à travers ces leviers qu’il devient possible de transformer les perceptions, afin que les femmes ne soient plus perçues comme une menace, mais reconnues comme des partenaires à part entière dans la construction d’une société juste, inclusive et solidaire.
Références
Bard, C. (1999). Un siècle d’antiféminisme. Fayard.
Bard, C., Blais, M., & Dupuis-Déri, F. (2019). Antiféminismes et masculinismes d’hier et d’aujourd’hui. Presses Universitaires de France.
Bouglé-Moalic, A.-S. (Dir.). (2025). L’éternel antiféminisme : Réflexions contemporaines autour de deux textes antiféministes. Presses Universitaires de Caen.
Descarries, F. (2005). L’antiféminisme « ordinaire ». Recherches féministes, 18(2), 137–151. https://doi.org/10.7202/1011121ar
Descarries, F. (2015). L’antiféminisme, expression sociopolitique du sexisme et de la misogynie : « C’est la faute au féminisme ! ». In D. Lamoureux & F. Dupuis-Déri (Dir.), Les antiféminismes : Analyse d’un discours réactionnaire (pp. 75–89). Les Éditions du remue-ménage.
Ferrari, P. (2023). Formés à la haine des femmes : Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux ? Jean-Claude Lattès.
Laffut, F. (2015). Femmes contre le féminisme ou l’antiféminisme ordinaire. Centre de Vérité et de Formation pour l’Égalité (CVFE). https://www.cvfe.be/publications/analyses/221-femmes-contre-le-feminisme-ou-l-antifeminisme-ordinaire
Magloire, D. (2018). L’antiféminisme en Haïti. In S. Lamour, D. Côté, & D. Alexis (Dir.), Déjouer le silence : Contre-discours sur les femmes haïtiennes (pp. 199–212). Les Éditions du remue-ménage.
Mansbridge, J., & Shames, S. S. (2012). Vers une théorie du backlash : La résistance dynamique et le rôle fondamental du pouvoir. Recherches féministes, 25(1), 151–162. https://doi.org/10.7202/1011121ar
Matot, B. (2017). Ces femmes antifemmes. Lemieux Éditeur.
Ward, T. (2023, 29 novembre). Experts explain the damage labeling “pick me” girls can do. CNN. https://amp.cnn.com/cnn/2023/11/29/health/pick-me-girls-wellness
Olibrice, W. C. (2024). L’activisme numérique comme outil de lutte contre les inégalités femmes-hommes : Le cas des campagnes Facebook en Haïti de 2017 à 2023 [Mémoire de master non publié, Université Mohammed Premier d’Oujda, Maroc].
À propos de l'auteure