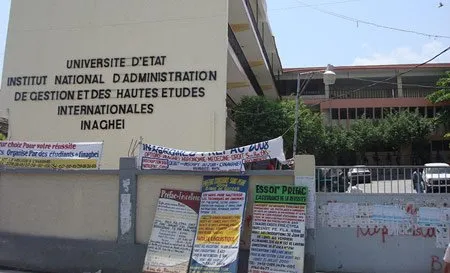Table des matières
Dans une interview accordée au Listín Diario, Fritz Alphonse Jean articule une lecture géopolitique de la crise haïtienne. Il repositionne Haïti dans une dynamique régionale de criminalité transnationale, tout en esquivant les angles morts de l’action étatique. Son discours révèle autant une tentative de cadrage politique qu’un aveu d’impuissance institutionnelle.
Dans un contexte d’extrême instabilité en Haïti, le président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, a accordé une interview exclusive au journal dominicain Listín Diario. Pendant près d’une heure, il a abordé sans détour la crise sécuritaire, les tensions migratoires, les relations avec la République dominicaine et les perspectives électorales du pays. Voici les cinq principaux enseignements à retenir de cet entretien.
1. Une crise haïtienne désormais transnationale
Le président a clairement posé les termes : la violence en Haïti ne se limite plus à des affrontements locaux. Elle est structurée autour de réseaux de criminalité transnationale : trafic de drogue, d’armes, de personnes, et même d’organes. Selon lui, ces flux illicites impliquent des acteurs présents en République dominicaine, à Miami, en Colombie ou en Jamaïque. En mettant en avant ces connexions régionales, il cherche à élargir le champ de responsabilité, mais cette stratégie pourrait aussi diluer l’urgence de réformes internes.
2. Une coopération sécuritaire encore embryonnaire avec la République dominicaine
Fritz Alphonse Jean insiste sur la nécessité d’une coopération plus poussée entre Haïti et son voisin. Il cite l’arrestation récente de membres des forces de sécurité dominicaines impliqués dans des trafics à destination d’Haïti. Si cette coopération est prometteuse, elle semble pour l’instant limitée à des réponses ponctuelles, sans véritable mécanisme bilatéral de coordination. La méfiance historique entre les deux pays continue de peser lourd.
3. Le rapatriement massif des migrants, une bombe sociale
Interrogé sur les expulsions en hausse de migrants haïtiens, le président tire la sonnette d’alarme. Il affirme que le gouvernement haïtien n’a ni les moyens matériels ni les capacités institutionnelles pour accueillir dignement ces retours, dans un contexte de violence généralisée et de crise humanitaire. Il évoque même le risque de voir ces migrants – parfois sans identification – grossir les rangs des gangs. Une alerte grave, mais sans proposition concrète à ce stade.
4. Une mission internationale présente, mais encore peu visible
La mission multinationale déployée depuis octobre 2024, notamment sous l’égide du Kenya, suscite un certain espoir. Le président affirme qu’elle a renforcé la confiance de la population et soutenu des batailles importantes, notamment dans la région de Port-au-Prince. Mais il reconnaît aussi un manque de ressources et un déficit de communication, ce qui nourrit l’impression d’inefficacité. L’opacité de la stratégie et le flou sur la coordination avec les autorités haïtiennes suscitent des interrogations.
5. Des élections promises, mais suspendues à la sécurité
Enfin, Fritz Alphonse Jean réaffirme son engagement à organiser des élections en novembre 2025. Un Conseil électoral provisoire est en place, et un comité réfléchit à une réforme constitutionnelle, notamment pour permettre le vote de la diaspora. Mais là encore, tout est conditionné à un retour à la sécurité. En creux, le message est clair : sans progrès dans la lutte contre les gangs, le calendrier démocratique reste suspendu.
En conclusion
L’interview du président du Conseil de transition est à la fois une opération de communication internationale et un diagnostic sans fard. Si certains constats sont lucides, les réponses concrètes manquent encore de clarté. Entre appel à la coopération régionale et reconnaissance des limites de l’État haïtien, c’est un exercice d’équilibrisme diplomatique – dans un pays où la marge de manœuvre politique est aujourd’hui aussi étroite que le couloir humanitaire.
Sous couvert de lucidité géopolitique, l’interview du président trace les contours d’un État en retrait, dépendant d’alliés extérieurs et d’opérations internationales pour exister. Le récit de la souveraineté demeure incantatoire. Les leviers réels d’action apparaissent dispersés, soumis à des logiques d’opportunité plus qu’à une volonté politique structurée.