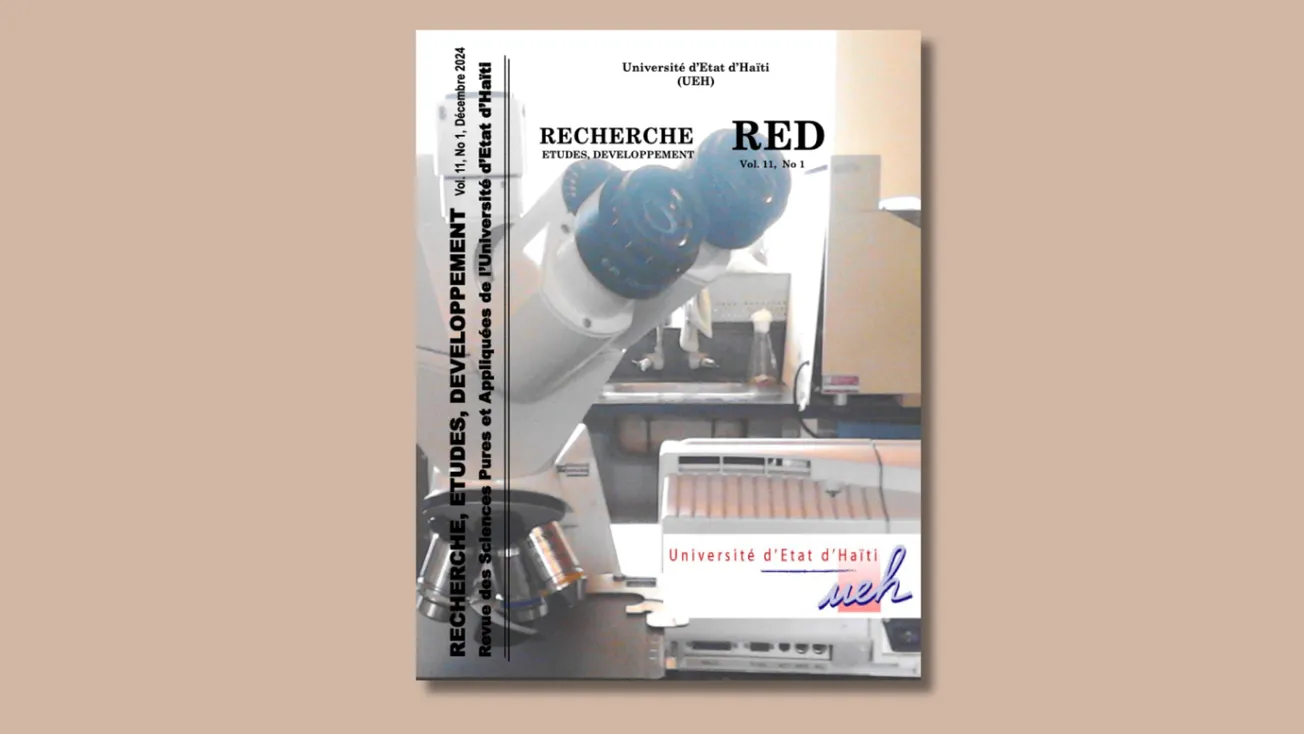Table des matières
Il est des mots qui enferment, et des récits qui asphyxient les peuples. Parmi eux, celui de la malédiction haïtienne plane comme un voile tenace sur l’histoire d’un pays qui, pourtant, a marqué le monde par l’éclat d’un geste de liberté inouï. Dans un entretien d’une rare lucidité accordé à la revue L’Histoire (mai 2025), l’écrivaine haïtienne Yanick Lahens démonte avec force et clarté cette construction idéologique.
Elle s’attaque à la rhétorique de la « malédiction » d’Haïti, souvent invoquée pour justifier les catastrophes naturelles, la pauvreté chronique et l’instabilité politique du pays. Elle rejette catégoriquement cette idée, qu’elle qualifie de « terme dangereux » (Lahens, 2025), alimentée par une ignorance tenace, et propose à la place une lecture structurée et historique des origines de la situation haïtienne.
Elle met en avant une série de « hasards » climatiques, géographiques, géologiques, mais insiste surtout sur le hasard historique fondamental : celui de l’indépendance de 1804. Ce « hasard » n’en est pas un. Haïti est le premier État noir indépendant issu d’une révolution d’esclaves, et le seul à avoir vaincu militairement un empire colonial européen pour abolir l’esclavage. Ce geste d’émancipation radicale constitue une démesure dans l’ordre du monde qui, selon Lahens, ne pouvait rester impunie. Comme l’a brillamment formulé Christiane Taubira : « On a fait payer très cher aux Haïtiens l’audace d’avoir vaincu Napoléon » (Taubira, 2020). Cette indépendance, que l’Occident n’a jamais digérée, a exposé Haïti à une longue histoire de marginalisation internationale et de punition structurelle.
Lahens revient ainsi sur l’indemnité imposée par la France en 1825, conditionnant la reconnaissance politique d’Haïti à un paiement colossal de 150 millions de francs-or. Ce tribut, extorqué à une nation née dans la ruine, inaugure selon elle une logique néocoloniale qui préfigure les futurs rapports Nord-Sud : « Haïti est la matrice de ces relations », affirme-t-elle. Ce fardeau de la dette a plongé le pays dans une spirale économique infernale et durable, qui n’a connu de répit qu’à partir du milieu du XXe siècle, mais au prix d’une désorganisation structurelle du développement.
Pour Lahens, cette dette est aussi au cœur d’un « silence historique », tant en France qu’en Haïti. Ce silence, analysé par Michel-Rolph Trouillot dans Silencing the Past (1995), n’est pas un oubli accidentel, mais une stratégie de pouvoir visant à effacer de la mémoire collective les événements qui dérangent l’ordre établi. L’indépendance d’Haïti représente ce que Trouillot appelle un « impensable historique » : une révolution qui remet radicalement en cause les catégories dominantes du savoir, de la race et de l’autorité. Ainsi, les faits sont souvent minorés, tus ou reconfigurés dans des narratifs rassurants pour les puissances dominantes. Dans ce contexte, la « malédiction haïtienne » n’est rien d’autre que le produit d’un récit colonial pérenne, masquant les responsabilités systémiques.
Lahens étend sa réflexion à la fracture interne de la société post-1804, marquée par le clivage entre les élites créoles occidentalisées et les populations rurales bossales, fondatrices d’un contre-modèle civilisationnel. Cette culture populaire, structurée autour du créole, du vodou, du lakou et de l’agroforesterie, a été marginalisée dans les textes constitutionnels et les politiques publiques, au profit d’un modèle urbain et centralisateur. Elle rappelle que cette « civilisation du pays en dehors » n’a jamais été pensée dans le récit national dominant, une omission qui, là encore, relève du silencing analysé par Trouillot.
Enfin, Lahens souligne l’insuffisante place accordée à l’esclavage et à la dette dans les récits historiques, littéraires et scolaires en Haïti. Ce n’est que récemment, à travers des initiatives comme Inisyativ 2025, que ces thèmes ont été réinvestis dans l’espace public, les réseaux sociaux et les universités, témoignant d’une volonté populaire de reconstituer une mémoire confisquée.
Critique
Cet entretien incarne un acte de déconstruction mémorielle et politique, fondé sur une pensée lucide et rigoureuse. Lahens articule avec finesse histoire, mémoire, dette, littérature et langue pour démontrer que ce que l’on nomme « malédiction » est en réalité le produit de violences systémiques et de récits biaisés. Elle exhume les racines profondes d’un isolement imposé à Haïti dès son indépendance, du scandale de la dette de 1825 et de l’oubli entretenu autour de cette « démesure » historique qu’a constituée la révolution haïtienne.
Reprenant les mots de Christiane Taubira (2020), on comprend que l’audace d’avoir vaincu Napoléon fut un affront que le monde occidental n’a jamais vraiment pardonné. L’indépendance haïtienne, en rompant avec l’ordre colonial et racial dominant, est devenue un acte subversif dont le prix a été payé par les générations suivantes.
En convoquant les travaux de Michel-Rolph Trouillot, Lahens situe Haïti au cœur des enjeux de l’histoire globale, dans un effort salutaire de relecture critique et de réappropriation narrative. Sa parole engage à dépasser les mythes pour reconstruire un horizon de justice historique.
Références
Lahens, Y. (2025). « Il n’y a pas de malédiction ! », L’Histoire, n°531, mai 2025, p. 2-5.
Taubira, C. (2020). Nuit d’épine. Paris : Plon.
Trouillot, M.-R. (1995). Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston : Beacon Press.
À propos de l'auteur