Table des matières
Alors que la crise sécuritaire perdure, l’Université d’État d’Haïti, avec le soutien du PNUD et de l’OIM, mobilise chercheurs et institutions autour d’un programme de formation et de recherche sur les relations haïtiano-dominicaines.
Une université mobilisée malgré la tourmente
Dans un contexte d’effondrement institutionnel et d’insécurité persistante à Port-au-Prince, le Centre en Population et Développement (CEPODE) de l’Université d’État d’Haïti (UEH) poursuit son projet de dialogue binational en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-Haïti) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), financé par les Fonds pour la consolidation de la paix. Du 20 au 23 mars 2025, un atelier scientifique et de formation se tient à Port-au-Prince autour des grands enjeux des relations haïtiano-dominicaines, avec pour objectif affiché de produire des savoirs utiles aux décideurs politiques dans une perspective de coopération régionale.






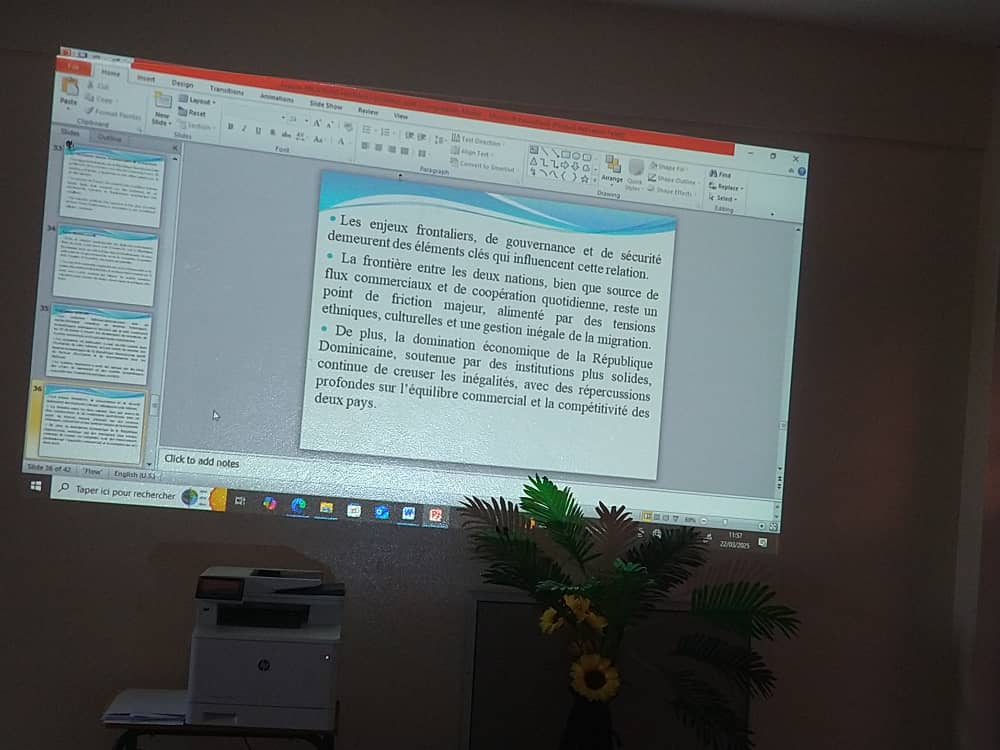


D’une intégration rêvée à une diplomatie fragmentée
Dans son propos introductif, le chargé de projet Hancy Pierre évoque un modèle oublié d’union entre Haïti et la République dominicaine : le traité d’union signé le 9 novembre 1874. Ce précédent, bien que resté sans suite concrète, préfigure les logiques contemporaines d’intégration régionale, comme celles de l’Union européenne ou du MERCOSUR. Pourtant, l’histoire récente est marquée non pas par l’intégration, mais par les tensions croissantes : refoulements de migrants, fermeture unilatérale de frontières, conflit autour du canal de la rivière Massacre.
La frontière au cœur du programme de formation
Les 22 et 23 mars ont été consacrés à deux journées thématiques réunissant universitaires et spécialistes. Le professeur Kénel Senatus, intervenant sur la question des relations bilatérales, appelle à une diplomatie active et professionnalisée. Selon lui, « il est encore possible que les deux peuples puissent s’entendre, peu importe qu’il y ait des tensions ». Il déplore cependant l’absence de volonté politique en Haïti pour faire avancer la Commission mixte binationale, et critique le laxisme diplomatique face à des logiques dominicaines souvent marquées par des replis nationalistes.
Le professeur Christian Toussaint, spécialiste des questions frontalières, a quant à lui soulevé l’archaïsme des traités encadrant la frontière terrestre et le vide juridique concernant les frontières maritime et aérienne. Il rappelle que l’incident diplomatique survenu en 2023, lorsque le Premier ministre haïtien Ariel Henry a été empêché d’atterrir en République dominicaine, illustre cette absence de régulation bilatérale cohérente. Il appelle à un traité sur la frontière maritime et insiste sur la nécessité de reconnaître les ressources partagées comme enjeux géostratégiques majeurs.
Décentralisation, migration et diplomatie locale
Le dimanche 23 mars, les docteurs Paul Antoine Bien-Aimé et Glodel Mézilás ont respectivement abordé les questions de décentralisation et de migration. Pour Bien-Aimé, le développement local des communes frontalières est la condition d’une interface diplomatique efficace, capable de réduire la dépendance exclusive à la diplomatie d’État. Mézilás, de son côté, est revenu sur les dynamiques de la migration haïtienne vers la République dominicaine, en rappelant la dimension humaine et structurelle du phénomène, bien au-delà des logiques de gestion sécuritaire.
Les interventions soulignent toutes une même ligne de force : sans renforcement de l’État local, structuration des données, et dialogue académique soutenu, les politiques migratoires resteront réactives, déséquilibrées et peu durables.
Vers une redéfinition du rôle de l’université
En impliquant étudiants, chercheurs, institutions publiques et partenaires internationaux, le CEPODE tente de replacer l’université au cœur de la production de connaissances stratégiques sur les enjeux frontaliers, dans une logique de co-construction d’expertise. L’atelier de Port-au-Prince marque la première étape d’un cycle de formations et de recherches qui se poursuivra dans les communes frontalières d’Ouanaminthe, Belladère, Anse-à-Pitres et Ganthier, où les tensions de terrain sont les plus palpables.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des travaux antérieurs du CEPODE, mais dans un contexte nettement plus périlleux. La mobilisation scientifique actuelle apparaît donc comme un acte de résistance intellectuelle, dans un pays où la crise politique fragilise les institutions de savoir et marginalise la recherche dans les politiques publiques.
Un pari audacieux sur le savoir comme levier diplomatique
Le projet de dialogue binational de l’UEH ne prétend pas résoudre les différends structurels entre Haïti et la République dominicaine. Cependant, il propose un autre chemin : celui d’un dialogue fondé sur la connaissance, l’histoire partagée, l’expertise locale et la rationalité politique. Dans un contexte où les rapports de force dominent, miser sur la diplomatie académique et la formation des jeunes chercheurs constitue une tentative inédite de produire des leviers alternatifs à la crispation et à l’impasse.










