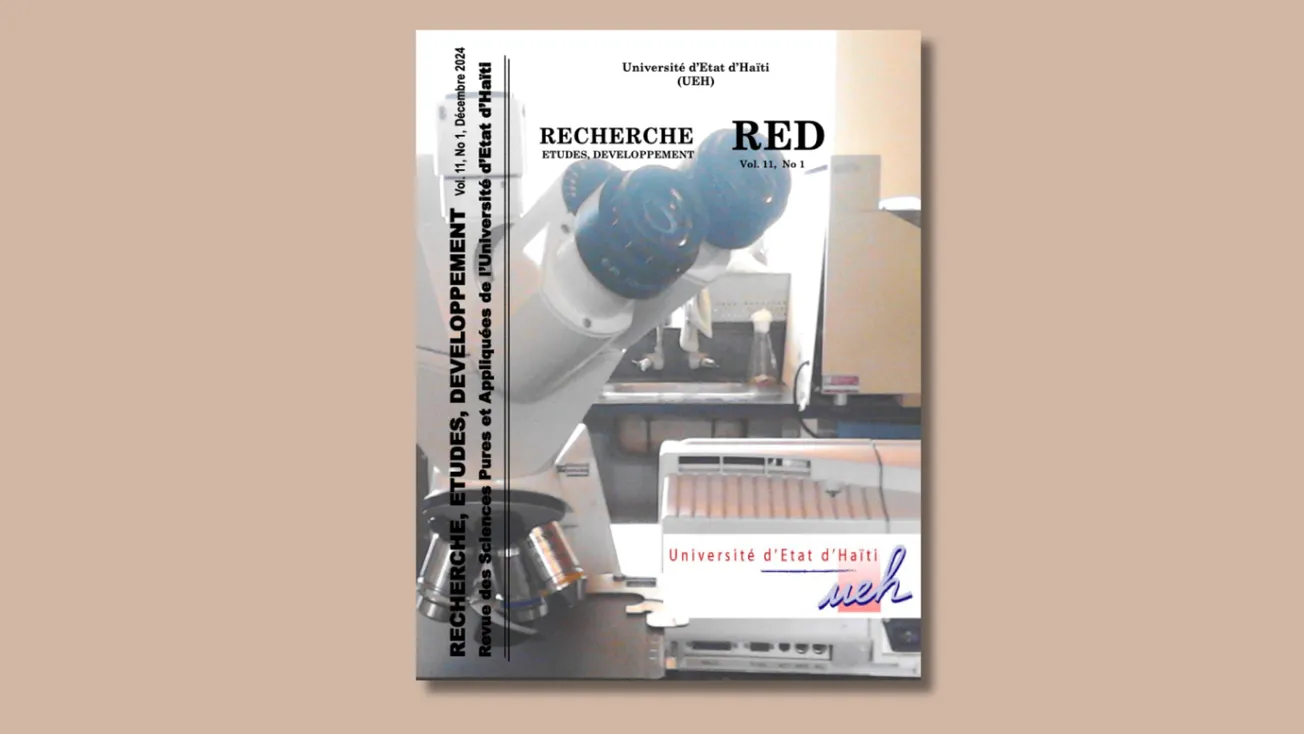Table des matières
L’Université d’État d’Haïti, à travers le Centre en Population et Développement rattaché à la Faculté des Sciences Humaines, poursuit ses activités de recherche-formation, d’enquêtes frontalières et de diffusion. Après avoir organisé des ateliers thématiques pendant quatre jours à Port-au-Prince, l’attention se porte désormais sur le point frontalier officiel de Ouanaminthe. Ainsi, du 2 au 9 avril 2025, des ateliers thématiques sont programmés à titre de réplique.
Lors de la première journée, le 2 avril 2025, les thématiques abordées étaient les suivantes :
- La question frontalière dans le cadre des relations haïtiano-dominicaines ;
- Les relations haïtiano-dominicaines : historique, enjeux et défis.
Ces sujets ont été développés respectivement par le Dr Gabriel Dorino Ambroise et la Dre Mainsmy-Mary Fleurant.
La deuxième journée a débuté à 10 h avec une intervention du professeur Simbert Aristide sur le thème : « Décentralisation et développement local des communes frontalières ». À 13 h, le Dr Vosh Dathus a animé un atelier sur les techniques d’enquête-diagnostic frontalière.
Nous avons tiré parti des interventions de la première journée, centrées sur la question frontalière et les relations haïtiano-dominicaines, pour produire une réflexion synthétique sur la coopération transfrontalière. Ainsi, dix-sept communes frontalières sont appelées à une concertation communale dans une perspective de coopération entre Haïti et la République dominicaine. La frontière poreuse de 300 km qui sépare les deux pays ne saurait se réduire à une logique de militarisation, au détriment des efforts de rapprochement et d’intégration régionale.
Tout part d’un élan de coopération informelle entre les mairies intercommunales, qui nécessite aujourd’hui un encadrement juridique. En effet, du côté haïtien, le Ministère de la Planification et de la Coopération externe avait tenté, en 2015, de mettre en place un plan de développement intégré, avec pour objectif de valoriser les communes frontalières. Ce projet n’a pas abouti en raison des impondérables liés aux tensions politiques de l’époque. Une étude avait pourtant été réalisée à cette occasion, définissant quatre grands objectifs :
- Intégrer le territoire frontalier au territoire national ;
- Créer des pôles de croissance et de développement ;
- Construire un nouvel espace de développement économique et social ;
- Élaborer de nouvelles stratégies d’intégration sociale impliquant l’ensemble des corps de l’État.
Un intérêt croissant de l’État dominicain pour le développement frontalier se manifeste de plus en plus, là où cette question était autrefois marginalisée. La promotion de services publics dans les zones frontalières est désormais inscrite à l’agenda politique de l’État dominicain. Cela constitue une contribution nationale significative aux projets de développement transfrontalier soutenus par l’Union européenne, le PNUD et d’autres organismes internationaux.
Les disparités de part et d’autre de la frontière nuisent aux relations de stabilité, lesquelles sont généralement liées aux progrès économiques et sociaux ainsi qu’à l’existence de mécanismes de gouvernance binationale, souvent absents ou dysfonctionnels, et qui entravent le développement régional. En effet, la coopération transfrontalière est devenue un enjeu central dans les relations internationales entre États limitrophes. Elle renvoie à une dynamique de collaboration interétatique visant à réduire les disparités et à établir des partenariats durables.
L’expérience de l’Union européenne en est une illustration éloquente, notamment à travers le soutien apporté à certains États comme l’Espagne et le Portugal, qui connaissaient alors des retards économiques et faisaient face à divers obstacles institutionnels à leur intégration. Le Mercosur s’est également inscrit dans cette logique de solidarité régionale, notamment dans les cas du Paraguay et de la Bolivie à une certaine époque.
Le rôle traditionnel de la frontière mérite d’être repensé à la lumière des mutations économiques, politiques et culturelles, des dynamiques de la mondialisation et des effets croissants des migrations. C’est dans ce contexte qu’émerge, dans certaines circonstances, le concept de « transnation ». En effet, les tentatives d’assimilation et d’acculturation portent de moins en moins de fruits, en raison des ancrages identitaires de plus en plus affirmés.
Il convient également de souligner un important déficit juridique concernant la régulation des relations entre Haïti et la République dominicaine. La coopération haïtiano-dominicaine remonte à la période allant de 1860 à 1900, avec notamment l’union définie par le traité du 9 novembre 1874, intitulé Traité de paix, d’amitié, de commerce et d’extradition. Ce texte constitue l’un des antécédents historiques de la coopération transfrontalière, bien qu’elle n’ait pas été nommée ainsi à l’époque. Des accords additionnels ont été conclus en 1898 et 1899. Par la suite, des traités de délimitation de la frontière ont été signés en 1929, 1935 et 1936. Il fallut attendre 1952 pour qu’un nouvel accord porte sur l’embauchage des braceros haïtiens destinés à l’industrie sucrière en République dominicaine.
Les relations entre Haïti et la République dominicaine sont marquées par des tensions persistantes. La question des braceros continue d’empoisonner ces relations, notamment lorsque la société civile haïtienne et des organisations internationales de défense des droits humains ont dénoncé la maltraitance infligée aux travailleurs haïtiens en République dominicaine, assimilée à une forme d’esclavage moderne. Cela n’a toutefois pas empêché certains épisodes de détente entre les deux pays.
On peut ainsi citer l’ouverture diplomatique de 1979, qui s’est traduite par un rapprochement en vue de promouvoir des projets de coopération dans les domaines touristique, économique, culturel et commercial. C’est dans ce contexte qu’a été signé un accord entre les deux gouvernements pour la construction du barrage de Pedernales/Anse-à-Pitres, constituant un acte significatif de coopération transfrontalière. Cet accord de 1979 constitue également la base de l’entente ayant conduit à la création, en 1996, d’une commission mixte binationale. Celle-ci peut servir d’outil de coopération transfrontalière, notamment pour régler conjointement certaines problématiques découlant de la proximité géographique entre collectivités locales situées de part et d’autre de la frontière.
L’aménagement des services publics est un point d’intérêt majeur. Certaines communes dominicaines peu peuplées disposent de services sous-utilisés, alors que, côté haïtien, la demande est forte — et l’inverse est parfois vrai. Une meilleure coordination intercommunale pourrait remédier à ces déséquilibres.
La rivière Massacre, alimentée par la rivière de Jean de Nantes du côté haïtien et par les eaux de Capotille, constitue un enjeu commun de gestion des ressources partagées. Il est nécessaire d’instaurer une collaboration entre les communes de Capotille et de Loma de los Caballeros. L’historienne Suzy Castor a signalé la présence de gisements miniers le long de la frontière, dans les environs de la rivière Massacre. Toute exploitation éventuelle de ces ressources pourrait compromettre l’environnement immédiat partagé par les communes frontalières haïtiennes, si elle n’est pas encadrée par les normes rigoureuses d’évaluation des impacts environnementaux exigées, notamment par des institutions telles que la Banque mondiale.
Cela implique des efforts soutenus en vue de prioriser une coopération transfrontalière efficace, à même de résoudre les problèmes communs des collectivités voisines. Il est ainsi possible de créer des communautés de travail binationales dans le cadre de cette coopération, à travers la mise en réseau d’organismes interrégionaux, tels que l’IBERS et le CONANI (organisme dominicain en charge de la protection de l’enfance), pour prévenir les phénomènes de traite et de trafic. Cette coopération s’étend également à la lutte contre la criminalité transnationale grâce à la collaboration entre le CESFRONT (Corps spécialisé de sécurité frontalière dominicain) et la POLIFRONT (Police des frontières haïtienne).
Les commissions intergouvernementales sont révélatrices de la volonté de mettre en œuvre une coopération transfrontalière. C’est le cas de la création de la Commission Mixte Binationale haïtiano-dominicaine, bien que ses échanges soient restés jusqu’ici très limités. On note principalement des efforts de concertation à l’échelle locale, à travers les tables de concertation communautaires des deux côtés de la frontière.
Cependant, la dimension nationale demeure négligée. Il devient nécessaire de passer d’une coopération ponctuelle à une coopération institutionnelle, en renforçant le cadre juridique et en concluant des accords bilatéraux sur des enjeux d’intérêt commun. Car la coopération transfrontalière représente l’un des vecteurs essentiels de stabilité en Haïti.
Ouanaminthe, 3 avril 2025