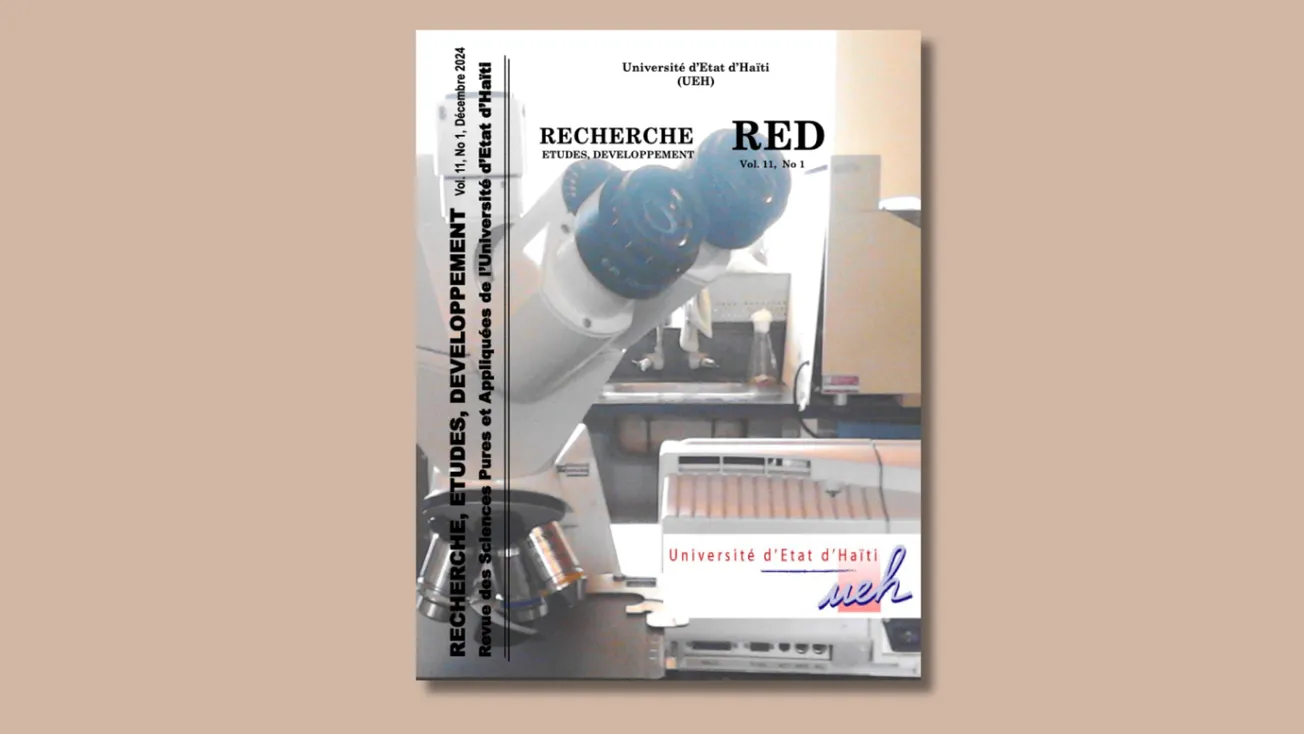Table des matières
Dans les années 1960-1970 en Haïti, la figure de Limena renvoyait à celle des marchandes de gros parcourant la Caraïbe pour le commerce, notamment celui des vêtements. Dans une acception plus ancienne, en Haïti, cette femme nommée Limena peut également être perçue comme une gran jipon. Elle incarne, en d’autres termes, la figure des Down Town Ladies décrites par Gina Athena Ulysse[1] : une commerçante informelle qui sillonne toute la Caraïbe et contribue à dessiner les contours du système économique régional.
Prise dans ce sens, la Limena haïtienne rappelle la figure de la Mama Benz togolaise[2], commerçante prospère circulant sur le continent africain pour le commerce du wax. Selon cette perspective, Limena désigne une femme déterminée, affichant son aisance de manière ostentatoire à travers ses vêtements et ses bijoux. Bref, c’est une femme valorisée, enviée, qui souvent ne se conforme pas aux normes traditionnelles régissant les relations hommes/femmes. Il n’est pas rare de voir cette femme recourir aux services d’un homme, désigné comme son secrétaire. Parfois analphabète, ce dernier est un homme lettré qui l’aide à tenir ses comptes et l’accompagne dans ses démarches administratives.
Au cours des années 1980, avec la libéralisation des douanes haïtiennes et le développement du commerce dit de Kennedy (pèpè[3]), la figure de la Limena devient moins présente dans le paysage socio-économique haïtien tel qu’il s’était défini dans les décennies précédentes. En conséquence, le sens du mot évolue. Cette nouvelle signification imaginaire se reflète dans la chanson Limena (Disip, 2016). Elle y est dépeinte comme une femme belle, fraîche, lumineuse, exceptionnelle, indépendante, s’habillant de manière ostentatoire avec goût et soin :
« Limena se yon gran fanm limen tankou flanm, li pa nan rans, toujou kanpe djanm […] yon fanm gran jipon, toujou alamòd […] bèl kikit, chapo, woujalèv toutan […] Yon fanm gran jipon toujou a la mòd ».
Se plaçant à la pointe de la mode et portant des vêtements de marque, ces femmes n’ont pas froid aux yeux : « Li toujou kanpe djanm ». Elles ne se laissent ni faire ni berner par les hommes. Éduquées – contrairement aux Limena de la première génération – elles disposent de compétences acquises qui leur permettent de bien gagner leur vie : « Limena se boss[4] ». L’originalité de cette figure réside dans le fait que ces femmes ne doivent leur succès qu’à elles-mêmes. Sur le plan social, Limena est une femme qui dispose de ses propres moyens pour subvenir à ses besoins : « Limena se yon gran fanm, li limen kon flanm […] ». Cela se manifeste par la consommation de biens matériels comme une grosse voiture, ou encore une résidence – voire plusieurs –, imposante si nécessaire, et considérée comme essentielle dans la manifestation et l’extériorisation de l’opulence[2]. C’est une femme qui sait aussi comment s’imposer dans un espace :
« Se pou gran fanm la ye, sipèsta kanpe la, pou gran jipon la ye, si w pa sa rale kò w ; Se pou bèl fanm la ye, Limena mwen ye, se Limena mwen ye ».
Conscientes de leur beauté, de leur pouvoir et de leur charme, ces femmes aiment également se faire voir, être admirées, notamment par les hommes. Se revendiquant lumineuses, aucune femme ordinaire ne peut rivaliser avec Limena. Femmes exceptionnelles, elles font fi des règles de séparation genrée des espaces et investissent les lieux de plaisir traditionnellement dominés par les hommes (bals, festivals, bars…).
Être Limena, c’est bénéficier du privilège d’une beauté physique, qui n’est pas sans importance dans une société où certaines femmes savent comment utiliser leur charme pour accéder à des ressources matérielles et immatérielles. Toutefois, lorsqu’une Limena s’assume pleinement, elle ne doit pas dépendre des hommes pour subvenir à ses besoins domestiques, incluant l’éducation de ses enfants et les soins apportés à ses proches. En même temps, cette figure doit posséder les compétences sociales et stratégiques nécessaires pour soutirer de l’argent aux hommes sans jamais donner l’impression d’en avoir besoin. Bref, Limena ne quémande pas. Elle obtient des ressources qu’elle investit dans des biens mobiliers et immobiliers, assurant ainsi son indépendance économique. Souvent, elle est aussi entrepreneure.
Vivre en Limena implique donc de développer un ensemble de compétences sociales permettant de mener sa vie de femme dans les limites tolérées par le patriarcat, sans jamais s’y soumettre pleinement. Elle incarne une figure liminaire, en bordure des normes : une figure ambivalente, parfois transgressive dans une logique féminine prohibitive, tout en restant paradoxalement acceptée. Se maintenir dans cette position suppose qu’une femme dispose d’assez d’atouts physiques et économiques pour être à la fois crainte et admirée.
Bien qu’elle bénéficie d’une certaine marge de manœuvre sociale, force est de reconnaître que Limena est également façonnée pour satisfaire le regard masculin, sans que les hommes ne s’investissent nécessairement dans des relations profondes avec elle. Cette femme n’exige rien des hommes ; elle tend à mener sa vie selon des modalités similaires à celles des hommes, sans pour autant échapper aux logiques de domination et d’exploitation propres à la condition féminine. En effet, quoique indépendante, Limena apparaît comme une femme consciente du regard masculin porté sur le corps des femmes. Elle est une femme regardée, qui cherche à tracer une voie entre ses préférences personnelles et les contraintes sociales.
Comme le souligne Mona Cholet[5] en parlant de beauté fatale, Limena met en lumière, dans le contexte haïtien, les paradoxes d’une femme à la fois objet et sujet, dont la féminité devient simultanément un lieu d’empowerment et de subordination. Ainsi, Limena apparaît comme une femme dont la liberté est contrôlée. Certes courageuses, fières et maîtresses d’elles-mêmes, ces femmes ne créent pas pour autant leurs propres espaces de plaisir ou d’auto-valorisation. Leur agentivité se déploie dans les limites de ce qui est jugé acceptable pour le maintien de l’ordre de genre dans notre société.[6].
Notes
[1] Ulysse, G. A. (2008). Downtown Ladies: Informal Commercial Importers, a Haitian Anthropologist and Self-Making in Jamaica. Chicago : University of Chicago Press.
[2] Toulabor, C. (2012). Les Nana Benz de Lomé Mutations D’une Bourgeoisie Compradore, Entre Heur et Décadence. Afrique contemporaine, 244(4), 69-80. https://doi.org/10.3917/afco.244.0069.
[3] Le terme pèpè désigne vêtements usages, des habits de seconde main importés, souvent en provenance des États-Unis ou du Canada.
[4] Boss désigne un homme qui dispose de moyens économiques importants, symbolisant réussite et autonomie.
[5] Chollet, M. (2012). Mona Chollet, Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminine. Zones.
[6] Depuis le séisme de 2010 et la dégradation continue des cadres socio-économiques, le mot Limena a de nouveau évolué. Il est désormais fréquemment utilisé comme une insulte pour dénigrer les jeunes filles et les femmes. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses blagues dégradantes circulent à propos de celles qui sont qualifiées de Limena. Souvent présentées comme des analphabètes, elles sont perçues comme superficielles, ne pensant qu’aux plaisirs, aux produits de beauté (lace), aux téléphones et aux vêtements de marque. Selon un épisode du podcast Netalkole TV (2018), la nouvelle Limena est décrite en ces termes : « Elle est une jeune fille qui entretient simultanément plusieurs relations, dont une avec un homme plus âgé à qui elle soutire de l’argent pour pouvoir s’entretenir et entretenir ses autres relations. » Il serait pertinent d’étudier l’évolution du terme Limena à travers les contextes économiques successifs, et d’analyser comment ces contextes influencent les rôles sociaux, notamment ceux des femmes et des hommes en Haïti.