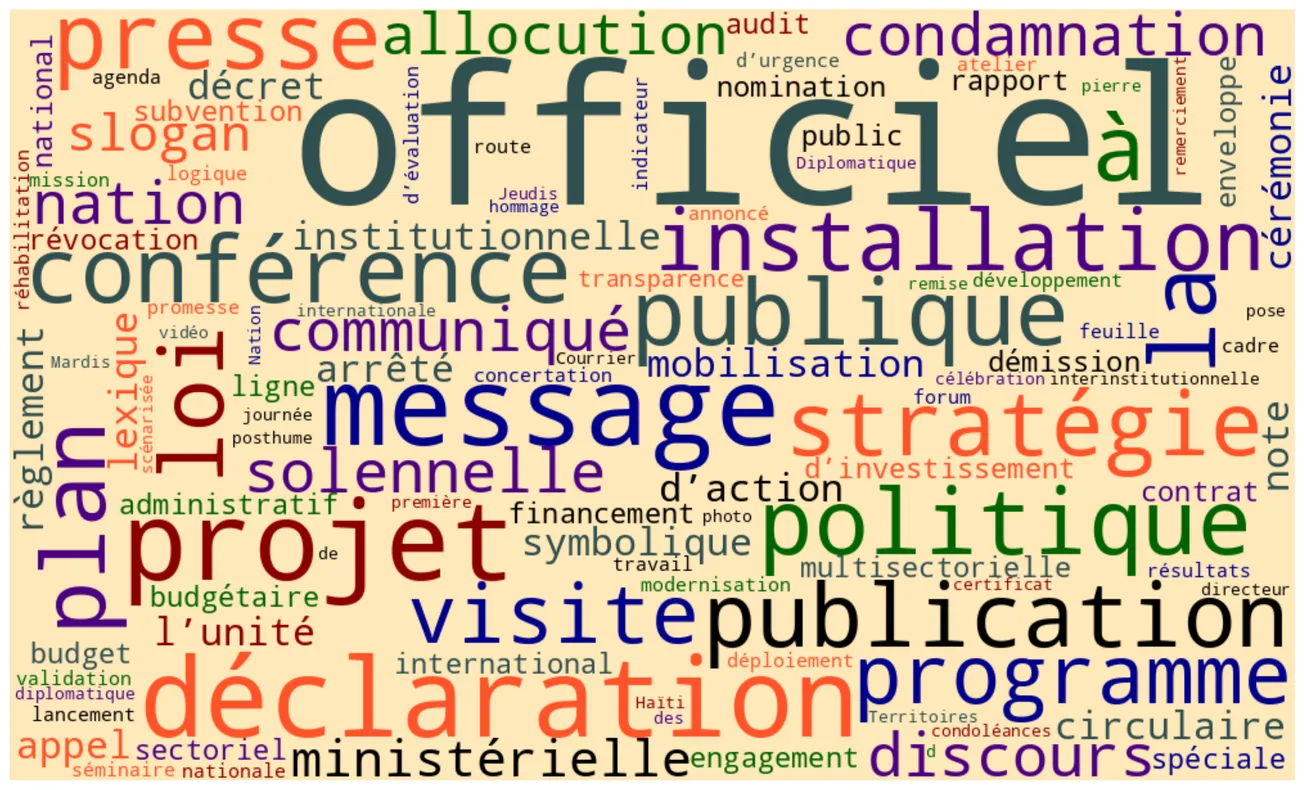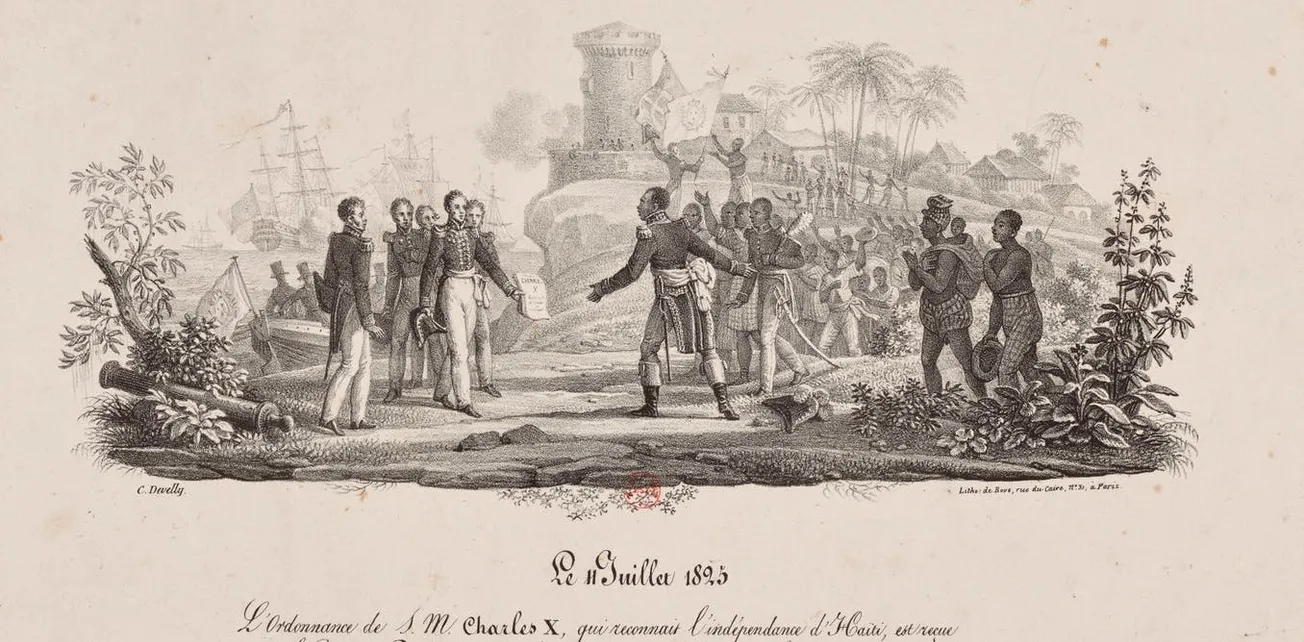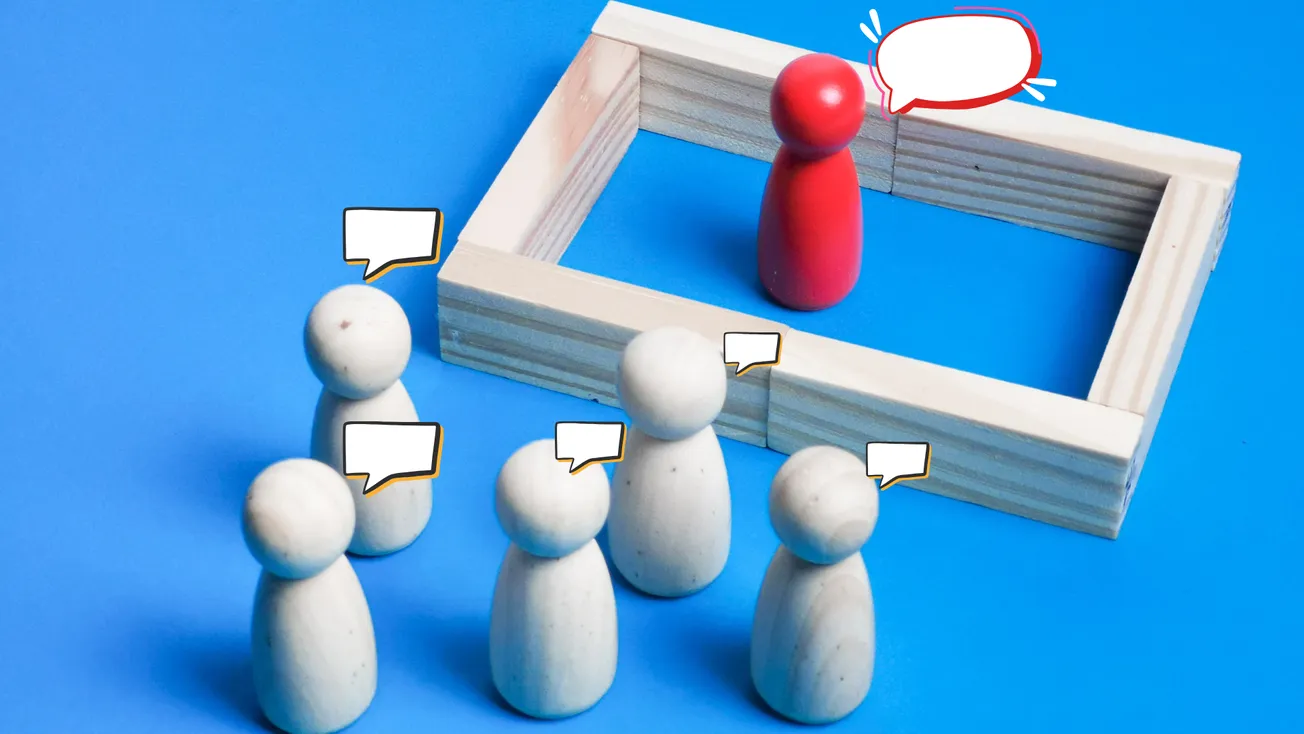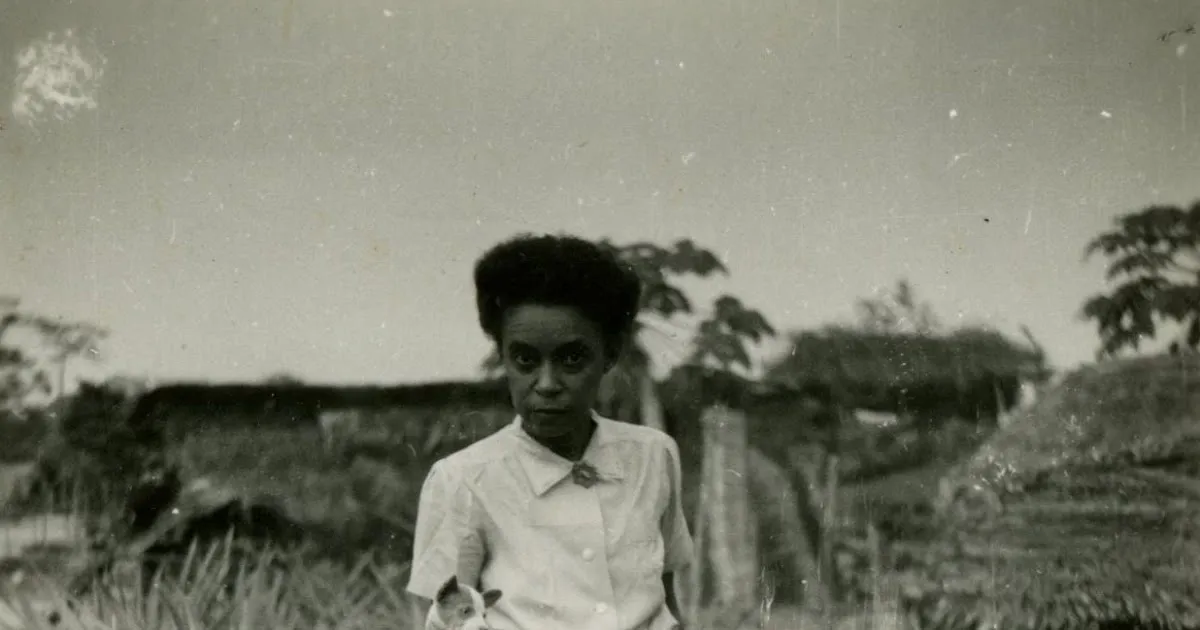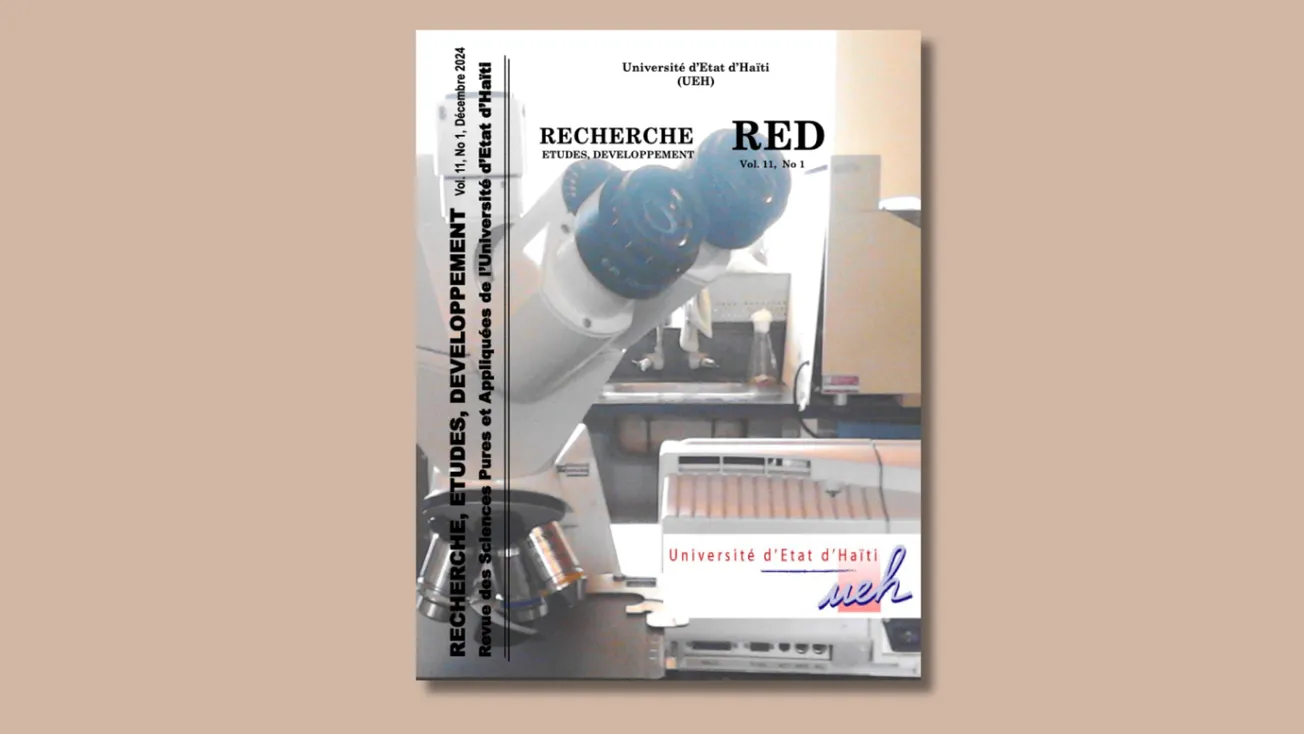Table des matières
Le 24 décembre 2024, le ministère de la Santé publique annonçait la réouverture de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), fermé depuis une attaque armée survenue dix mois plus tôt. Présentée comme un symbole de redéploiement de l’autorité publique dans un secteur stratégique du centre-ville de Port-au-Prince, la cérémonie officielle fut interrompue par une fusillade attribuée à la coalition de gangs Viv Ansanm. Deux journalistes et un policier furent tués, plusieurs personnes blessées, et les secours mirent près de deux heures à intervenir. Cette disjonction brutale entre l’affirmation institutionnelle d’un État en action et la réalité d’un territoire hors de contrôle n’est pas un accident : elle révèle un mode de gouvernance fondé non sur l’action effective, mais sur la mise en scène.
Cette scène, emblématique, condense une configuration devenue structurelle : un langage gouvernemental performé avec emphase, aussitôt contredit par les faits, suivi d’un communiqué standardisé, sans suite ni responsabilité. Ce décalage est au cœur de ce que j’appelle ici la politique du bullshit. Loin d’être un simple langage vide ou une communication maladroite, le bullshit constitue un régime discursif cohérent. Il simule l’action publique, légitime symboliquement l’absence de résultats et autorise la captation des ressources sans rendre de comptes.
Suivant la définition classique de Harry Frankfurt (2005), le bullshit désigne un discours indifférent à la vérité, qui ne cherche ni à dire le vrai ni à mentir, mais à produire une apparence. Florian Cova (2024) insiste sur son effet : il semble pertinent à première vue, mais se révèle creux ou trivial à l’analyse. Thorian R. Harris (2023) propose d’élargir cette notion à des formes non intentionnelles de bullshit, marquées par la négligence épistémique et l’absence d’engagement réel envers la vérification. Gerald A. Cohen (2002) complète cette perspective en montrant que le bullshit peut être identifié par la nature même de l’énoncé – inintelligible, trivial ou inconséquent – indépendamment des intentions de son auteur.
En croisant ces apports, je définis ici le bullshit gouvernemental comme tout discours ou pratique symbolique produit sans préoccupation sérieuse pour la vérité ni engagement réel envers sa réalisation. Il ne résulte pas toujours d’une manipulation consciente, mais fonctionne dans des contextes où les exigences de justification et de responsabilité sont suspendues. Ce discours ne vise pas tant à informer qu’à signifier : il occupe l’espace public pour maintenir l’illusion d’un État encore en fonction.
Plusieurs travaux récents ont contribué à affiner notre compréhension du bullshit en politique. Gligorić, Feddes et Doosje (2022) ont développé le concept de Political Bullshit Receptivity, mesurant la disposition des individus à adhérer à des discours creux, indépendamment de leur contenu. Petrocelli, Seta et Seta (2023) ont quant à eux analysé les effets cumulatifs de l’exposition au bullshit sur la cognition individuelle, montrant que la désinformation répétée peut renforcer la confusion épistémique. Enfin, Gibbons (2023) propose une lecture institutionnelle indirecte en montrant que le bullshit politique répond à des incitations rationnelles dans des systèmes d’interaction stratégique entre politiciens, électeurs et médias. Ces recherches s’inscrivent toutefois dans une approche centrée sur les individus et leurs biais de réception. Mon travail s’en distingue en analysant le bullshit comme régime discursif institutionnalisé – non seulement produit ou toléré par l’État, mais structurant activement les modalités de la gouvernance. Il s’agit donc de déplacer le regard : du récepteur au producteur, de la cognition individuelle à l’infrastructure discursive, et du mensonge opportuniste à l’organisation symbolique du pouvoir.
En Haïti, cette logique s’inscrit dans un mode de gouvernance performative, tel que décrit par Iza Ding (2022), où l’État mime les attributs de la bonne gouvernance – symboles, rituels, annonces – sans mise en œuvre effective. Lorsque cette performance échoue, elle produit une défusion (Alexander, 2011) : un écart trop grand entre le récit officiel et l’expérience vécue pour maintenir l’adhésion. Cette logique rejoint celle du simulacre (Baudrillard, 1981), où les signes du pouvoir circulent sans référent réel, déconnectés de toute effectivité politique.
Cet essai propose d’examiner la politique du bullshit en Haïti comme régime discursif, outil de mise en scène, mais aussi comme infrastructure de capture de l’État. Il avance l’idée que l’ineffectivité de l’action publique n’est pas fortuite, mais politiquement fonctionnelle. Elle permet aux élites de produire du langage normatif sans intention d’application, tout en revendiquant symboliquement leur autorité devant les citoyens, les bailleurs et l’appareil étatique lui-même.
L’analyse s’organise en trois temps. La première partie examine le bullshit comme mode de gouvernance performative, à travers l’analyse de plusieurs cas emblématiques. La deuxième partie interroge les mécanismes de diffusion, de réception et de circulation du bullshit dans l’espace public haïtien, en lien avec les mutations du champ médiatique. La troisième explore les effets sociaux et politiques de ce régime discursif, en montrant comment il participe à une désaffiliation citoyenne, à une culture du cynisme stratégique et à la consolidation d’un pouvoir sans responsabilité..
I. Le bullshit comme mode de gouvernance
1. Le bullshit à l’œuvre : une parole étatique répétitive, performative et désancrée
Dans tout régime politique, l’État gouverne par la parole. À travers lois, décrets, plans ou communiqués, il énonce des intentions, institue des normes et projette une image d’autorité agissante. Ces discours construisent un lien symbolique avec la société, traduisent une volonté politique supposée et revendiquent une légitimité. En inscrivant l’action publique dans un horizon discursif de rationalité, ils rendent l’État visible et crédible – fût-ce parfois seulement en surface.
Le langage étatique, ainsi structuré, ne relève pas simplement de l’accompagnement du pouvoir. Il constitue une modalité essentielle de l’exercice gouvernemental, parfois même sa seule manifestation tangible. Il devient une scène performative où promesse, autorité et illusion s’entrelacent. Comme l’a montré Pierre Bourdieu (1982), la parole d’État agit parce qu’elle est prononcée par une institution reconnue comme légitime, disposant du monopole de la violence symbolique. Michel Foucault (1978), quant à lui, a souligné la manière dont les régimes de vérité et les discours administrent les conduites, rendant le gouvernement possible sans recours direct à la coercition. Cette capacité de la parole étatique à instituer le réel tout en escamotant les effets concrets de l’action est également au cœur de l’analyse de Jean Baudrillard (1981), pour qui la société moderne fonctionne par simulation : l’État met en scène sa propre efficacité à travers une profusion de signes, de langages et de pseudo-événements. Plus récemment, Iza Ding (2022) a mis en lumière les dimensions performatives et affectives de la gouvernance autoritaire, dans lesquelles l’apparence de rationalité et d’action tient parfois lieu de politique effective, dans un registre qu’on pourrait qualifier de bullshit performatif.
Mais en Haïti, cette dynamique est profondément altérée. Le pays traverse depuis plus d’une décennie une crise systémique, caractérisée par l’effondrement progressif des institutions publiques, la paralysie des mécanismes de représentation, la désintégration du contrat social et, plus récemment, par l’absence même d’un ordre constitutionnel reconnu. Dans ce contexte, la parole de l’État, portée par un gouvernement dit de consensus dont les représentants n’ont été ni élus ni investis par une procédure constitutionnelle, est vidée de sa capacité à structurer le réel. Elle ne peut plus produire de normes effectives ni orienter l’action collective. Pourtant, cette parole continue d’exister, de se déployer, de saturer l’espace public – à travers des communiqués, des notes officielles, des lancements de programmes, des ateliers de consultation, des nominations et installations de directeurs généraux, des cérémonies de lancement ou de signature, autant de rituels discursifs qui simulent l’action et entretiennent l’illusion d’un État en marche. C’est là qu’intervient le bullshit, non comme accident ou dérive, mais comme dispositif discursif de gouvernance. Il constitue un cadre épistémologique de gouvernement, une manière de produire de la parole sans lien avec la véracité, l’action ou la responsabilité. Il permet à l’État de simuler sa présence, de mettre en scène son autorité, tout en masquant sa propre capture par des logiques d’impuissance, de fragmentation et de désengagement.
Pour illustrer cette logique, je prends appui sur trois communiqués publiés par la Primature à la suite d’événements violents survenus en décembre 2024 : le massacre de Wharf Jérémie, l’attaque contre l’hôpital Bernard Mevs et l’assaut contre l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti. Les documents analysés sont les suivants : « Massacre à Wharf Jérémie » (également diffusé sous le titre générique « Communiqué de presse de la Primature », le 9 décembre 2024) [a], « Le Gouvernement condamne fermement l’attaque contre l’Hôpital Bernard Mevs et prend des mesures immédiates pour garantir sa sécurité » (17 décembre 2024)[b], et « Attaque contre le Plus Grand Centre Hospitalier de la capitale : le Gouvernement prend position avec fermeté » (24 décembre 2024) [c].
Bien que publiés à des dates différentes et dans des contextes distincts, ces textes obéissent à une même grammaire : celle d’un langage figé, autoréférentiel et saturé de formules performatives. Leur analyse permet de saisir comment le bullshit fonctionne concrètement comme modalité de gouvernement : par la répétition de structures discursives, par la mise en scène d’une autorité sans prise sur le réel, et par la neutralisation de toute exigence de vérité, de responsabilité ou de suivi.
Afin d’objectiver cette dynamique, une lecture croisée des trois communiqués a été effectuée. Le tableau ci-dessous en résume les principales caractéristiques : délais de réaction, vocabulaire mobilisé, identification des auteurs et des victimes, mesures annoncées, tonalité générale. Cette comparaison fait apparaître des régularités formelles frappantes, révélatrices d’un usage stratégique du langage étatique pour occuper l’espace public sans organiser de réponse effective.
Tableau 1. Analyse comparative de trois communiqués officiels publiés en décembre 2024
|
Critères d’analyse |
Massacre de Wharf Jérémie (9 décembre
2024) [a] |
Attaque Hôpital Bernard Mevs (17
décembre 2024) [b] |
Attaque Hôpital Universitaire (24
décembre 2024) [c] |
|
Date de l’incident |
6-7 décembre 2024 |
17 décembre 2024 |
24 décembre 2024 |
|
Délai de réaction officielle |
2-3 jours |
Même jour |
Même jour |
|
Identification de la cible |
Wharf Jérémie (Cité Soleil) |
Hôpital Bernard Mevs (Village
Solidarité, Route de l’aéroport) |
« Le plus grand centre hospitalier
de la capitale » (HUEH) |
|
Identification des auteurs |
Nominative et précise : « Micanor
Altès, alias Wa Mikanò, et consorts » |
Générique : « gangs armés » |
Vague : « individus
armés » |
|
Bilan humain communiqué |
« Plus d’une centaine » de
morts « Principalement des vieillards sans défense » |
Aucun bilan mentionné |
Aucun bilan mentionné |
|
Dégâts matériels mentionnés |
Non mentionnés |
Non mentionnés |
Implicitement importants (nécessité de
« réhabilitation ») |
|
Qualification de l’acte |
« Massacre abject », « Acte
de barbarie », « Crime monstrueux », « Carnage
inqualifiable » |
« Attaque armée
inqualifiable », « Acte de violence », « Agression
inacceptable » |
« Acte odieux », « Barbarie »,
« Agression inacceptable » |
|
Mesures annoncées |
« La machine répressive de l’État
sera déployée », « Traquer, capturer et traduire devant la
justice », Aucune mesure spécifique détaillée |
« Présence permanente de la PNH »,
« Ressources supplémentaires », « Plan de sécurité renforcé » |
« Sécuriser les lieux », « Protéger
le personnel », « Identifier et appréhender les criminels », « Réhabilitation
et réouverture rapide » |
|
Soutien aux victimes |
Expression de « profondes
sympathies », Aucune mesure concrète |
Non spécifié |
« Le personnel médical et les
victimes seront soutenus et protégés », Sans précision des modalités |
|
Appel à la population |
Aucun appel direct |
« Appel à l’unité et à la
résilience » |
Appel à « la vigilance et à la
solidarité » « Rejeter toute forme de peur ou de désespoir » |
|
Contextualisation |
Aucune |
Mention du rôle de l’hôpital dans le
système de santé |
Référence vague à « cette
période difficile » |
|
Signature/attribution |
Non spécifiée, attribution au « Gouvernement » |
Non spécifiée, mention du Premier
ministre |
Non spécifiée, attribution au
« Gouvernement » |
|
Temporalité annoncée |
Aucune indication de calendrier d’action |
Immédiate (mesures
« désormais » en place) |
« Réouverture prochaine »
(sans calendrier précis) |
|
Références à d’autres attaques |
Aucune |
Aucune |
Aucune référence à l’attaque de Bernard
Mevs une semaine plus tôt |
|
Mots-clés spécifiques |
« Machine répressive », « Éradiquer
les groupes armés », « Sacrifice » |
« Infrastructures critiques »,
« Aucun sacrifice ne sera trop grand » |
« Forces du chaos », « L’espoir
triomphera » |
|
Ton dominant |
Vengeur, punitif |
Déterminé, administratif |
Défensif, mobilisateur |
Ce tableau révèle une opération plus ou moins structuré de décontextualisation symbolique. Les événements – massacre de civils à Wharf Jérémie, attaque de l’hôpital Bernard Mevs, assaut contre le plus grand hôpital public du pays – ne sont pas fondamentalement hétérogènes ; ils s’inscrivent dans une même séquence de crise sécuritaire, marquée par la fragmentation du territoire, la paralysie de l’appareil étatique et la violence armée systémique. Tous relèvent d’un même effondrement de l’autorité publique, affectant à la fois les quartiers populaires, les infrastructures critiques, et les services de santé. Pourtant, le langage gouvernemental évacue cette continuité. Il applique à chacun de ces événements une matrice discursive figée – condamnation morale, annonces vagues, lexique d’indignation –, sans les relier entre eux, sans produire de lecture d’ensemble, sans reconnaître leur inscription dans une trajectoire d’aggravation. Cette standardisation langagière a pour effet de neutraliser la dimension politique des faits. Cette standardisation langagière a pour effet de neutraliser la dimension politique des faits. Elle transforme des attaques coordonnées et structurelles en occurrences isolées, des symptômes d’un effondrement en incidents ponctuels — alors même que ces offensives armées se répètent depuis des années, gagnent en intensité et en portée, et ont conduit à la mise sous contrôle de plus de 85 % de la zone métropolitaine de Port-au-Prince par des groupes criminels. Le tableau donne ainsi à voir une parole d’État qui ne nomme ni la crise, ni ses causes, ni sa dynamique. Il illustre la fonction performative du bullshit : produire l’apparence d’une réponse étatique, tout en désactivant les conditions de la compréhension, de la mémoire et de la responsabilité.
2. Une parole d’État qui mime l’autorité
L’analyse de trois communiqués révèle une structure rhétorique rigide, fondée sur un registre d’autorité. Chacun d’eux s’ouvre sur une condamnation sans nuance – « massacre abject », « attaque inqualifiable », « barbarie », « crime monstrueux » – affirmant d’emblée la position de surplomb moral du gouvernement face aux événements. Cette langue de commandement, marquée par une intensité lexicale et un ton péremptoire, cherche à affirmer la souveraineté du pouvoir face à la violence. Elle adopte tour à tour un registre vengeur et punitif [a], déterminé et administratif [b], ou encore défensif et mobilisateur [c], selon les circonstances, sans jamais dépasser le cadre performatif qui la définit. Ces variations de ton ne traduisent pas une stratégie différenciée, mais une plasticité du langage de l’autorité, qui module son affect selon la scène à occuper, sans modifier la structure sous-jacente du bullshit. Cependant, cette posture d’autorité repose sur un dispositif vide.
Plus encore, ces textes suivent une trame rigide : condamnation initiale, expression de solidarité, promesses d’action, appel à l’unité. Ce schéma est reconduit, indépendamment de la nature des événements. Qu’il s’agisse d’un massacre de civils à Wharf Jérémie [a], d’une attaque ciblée contre un hôpital privé (Bernard Mevs) [b], ou de l’assaut contre l’Hôpital universitaire d’État (HUEH) [c], la structure discursive reste inchangée. Dans chaque cas, les auteurs sont désignés de façon imprécise ou générique (« individus armés », « gangs »), les bilans humains sont absents (b, c) ou évoqués de manière dramatique mais non vérifiable [a], les dégâts matériels sont sous-mentionnés ou implicites, et les mesures annoncées se limitent à des formulations vagues, sans mécanismes concrets de suivi.
La variation lexicale – de la « machine répressive » [a] aux « forces du chaos » [c], en passant par « aucun sacrifice ne sera trop grand » [b] – ne modifie en rien cette homogénéité profonde. Le langage est mobilisé pour simuler une prise sur les événements, mais sans jamais en produire une lecture située, encore moins une réponse articulée. La tonalité s’ajuste superficiellement (vengeur dans a, administratif dans b, mobilisateur dans c), mais la logique demeure la même : produire l’effet d’un pouvoir actif, sans en assumer les implications effectives.
Cette uniformité transforme la parole gouvernementale en rituel autoréférentiel. Elle produit une redondance creuse, où la répétition des séquences discursives remplace toute analyse des faits. Là où l’on attendrait une parole d’autorité capable d’assumer la crise, d’en nommer les causes, de la situer dans une trajectoire historique et de revendiquer la responsabilité de l’action publique, le discours officiel s’enferme dans des formules figées, répétées d’un communiqué à l’autre. On retrouve, par exemple, l’annonce d’un déploiement de « la machine répressive de l’État » pour « traquer, capturer et traduire devant la justice » les responsables [a], la promesse d’un « plan de sécurité renforcé » et d’une « présence permanente de la PNH » [b], ou encore l’engagement de « réhabiliter et rouvrir rapidement » un hôpital attaqué [c], sans qu’aucun calendrier, modalité concrète ni articulation stratégique ne soit précisé. Ces notes, souvent non signées, attribuées anonymement au « Gouvernement », se dispensent de toute mise en contexte, ne relient jamais les événements entre eux, et n’évoquent aucune attaque antérieure – comme si chaque drame surgissait de manière autonome et accidentelle.
Ce langage distancie symboliquement l’État de la crise sécuritaire, qu’il présente comme un phénomène extérieur, presque naturel. À travers des appels abstraits à « la résilience » [b], à « rejeter la peur » et à croire que « l’espoir triomphera » [c], il laisse entendre qu’il agira, sans jamais engager réellement sa parole ni se soumettre à une exigence de reddition de comptes. Autrement dit, l’autorité n’est pas démontrée, elle est mimée. L’État ne réagit pas, il joue son propre rôle. Ce décalage entre le ton et la réalité constitue une dimension fondamentale du dispositif : une performance d’autorité sans substance politique, où le bullshit discursif rejoint le simulacre symbolique pour mimer le pouvoir en l’absence d’effectivité.
3. L’effacement des faits derrière le style
Ce qui frappe dans les trois communiqués, au-delà de leur structure répétitive, c’est l’effacement systématique des faits concrets. Le traitement des données empiriques – bilans humains, nature des dégâts, identification des auteurs – est soit absent, soit imprécis, soit relégué au second plan derrière un habillage émotionnel. Le premier communiqué, relatif au massacre de Wharf Jérémie, mentionne « plus d’une centaine de morts, principalement des vieillards sans défense », mais les deux suivants, concernant les attaques contre les hôpitaux, ne donnent aucun chiffre, aucun détail sur les victimes, ni sur l’ampleur des destructions. À la place, le langage convoque un lexique d’indignation – « abject », « odieux », « inqualifiable » – qui dramatise sans décrire.
Cet effacement des faits ne relève ni de l’omission fortuite ni d’une imprécision bureaucratique. Il concerne des événements graves – massacres, attaques armées, destructions criminelles – qui, dans un État de droit, devraient être nommés, documentés, attribués et poursuivis en justice. Leur disparition du discours officiel ne tient donc pas à un défaut d’information, mais à un choix discursif visant à ne pas reconnaître la rupture que ces actes introduisent dans l’ordre institutionnel, ni à en tirer les conséquences.
Ce geste d’effacement permet à l’État d’éviter de reconnaître sa défaillance, d’esquiver la responsabilité, et surtout de suspendre l’exigence d’une réponse concrète. En substituant aux faits des formules dramatisantes, la communication officielle ne cherche pas à produire du sens, mais à générer un effet émotionnel immédiat. Elle déplace l’attention de la compréhension vers la réaction, de l’analyse vers la sidération – instaurant ainsi une double distanciation : épistémique, en renonçant à toute visée de vérité ou d’intelligibilité du réel ; et éthique, en évacuant la question de la responsabilité face aux événements.
Dans cette perspective, ce que le discours gouvernemental escamote, ce n’est pas seulement l’événement lui-même, mais la possibilité même de l’interpréter comme une faillite du pouvoir. C’est une stratégie de neutralisation symbolique : les faits sont absorbés dans un lexique d’indignation préfabriqué, qui interdit leur saisie comme faits politiques. Le langage de l’État ne reconnaît pas l’événement comme une abdication de souveraineté ; il le traite comme un accident regrettable, sans en tirer de rupture, de bilan ou de leçon.
Cette logique transforme la parole d’État en écran : les mots recouvrent les faits, les effets d’emphase court-circuitent toute exigence d’enquête ou de reddition de comptes. La vérité factuelle devient secondaire. Ce qui importe, c’est de projeter l’image d’un État en alerte, compatissant, ferme – une présence narrative plutôt qu’institutionnelle. Le bullshit, ici, ne nie pas la réalité ; il l’engloutit dans un langage désancré, détournant l’attention des dynamiques de violence pour reconduire un simulacre de souveraineté.
4. Le langage du pouvoir sans mémoire ni engagement
Dans les trois communiqués officiels examinés, la parole de l’État repose sur un double mécanisme de promesse désengagée et d’oubli programmé. D’un côté, chaque prise de parole annonce des mesures supposées incarner la réactivité gouvernementale : « la machine répressive de l’État sera déployée » [a], « une présence permanente de la PNH » [b], « un plan de sécurité renforcé » et une « réhabilitation rapide » [c]. Pourtant, ces promesses ne sont jamais accompagnées de précisions opérationnelles : ni calendrier, ni budget, ni mécanismes de mise en œuvre. Le langage officiel n’articule aucun plan d’action concret ; il se contente d’énoncer des intentions suspendues dans un futur indéfini. Il ne vise pas à gouverner, mais à donner l’apparence qu’il se passe quelque chose.
Ce discours performatif produit une présence symbolique sans substance. Il fonctionne comme un rituel de stabilisation, destiné à rassurer l’opinion publique ou les partenaires internationaux, sans jamais engager l’État dans une dynamique d’action vérifiable. Ce que ce langage promet, il ne le lie à aucune obligation. Il évacue ainsi à la fois la responsabilité politique (rien ne contraint l’État à agir réellement) et la mémoire institutionnelle (rien ne permet de comparer, d’évaluer ou d’apprendre des précédents). Chaque communiqué se présente comme une unité autonome, sans lien avec les événements antérieurs. L’attaque de l’Hôpital Universitaire [c] ne fait aucune référence à celle de Bernard Mevs [b], ni au massacre de Wharf Jérémie [a], comme si ces actes n’avaient aucune continuité.
Cette désarticulation narrative empêche la construction d’une intelligibilité partagée de la crise. Elle isole chaque événement pour mieux en désamorcer la portée politique. Ce refus de lier les faits entre eux est aussi un refus de reconnaître une crise de régime. Il permet à l’État de parler sans répondre, d’indigner sans agir, de compatir sans empathie réelle. La temporalité politique qui en résulte privilégie l’urgence perpétuelle, mais une urgence mise en scène, sans stratégie ni suivi. Ce régime discursif ne cherche ni la vérité, ni la responsabilité : il produit une autorité mimée, où le bullshit remplace l’engagement, et l’effet d’annonce tient lieu d’action publique.
II. L’écosystème informationnel et la circulation du bullshit : entre contraintes, usages et résistances
1. Des conditions structurelles qui favorisent la circulation du bullshit
La diffusion du bullshit dans l’espace public haïtien ne résulte pas simplement d’un effort de manipulation délibéré de la part de l’État. Elle s’inscrit dans un ensemble de contraintes structurelles – sécuritaires, économiques et médiatiques – qui réduisent les capacités critiques de la presse et favorisent la reproduction des discours gouvernementaux. Ces conditions transforment un langage creux en un langage dominant d’un État producteur d’insignifiance (Castoriadis, 1996).
D’un côté, les journalistes travaillent sous menace constante. Dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince – notamment Cité Soleil, Martissant, Bel-Air, Carrefour-Feuilles, Croix-des-Bouquets, Bas-Delmas (jusqu’à Delmas 30, au moment où je termine cet article) – couvrir un événement implique de s’exposer à des groupes armés ou à des représailles politiques. L’assassinat de Markenzy Nathoux et Jimmy Jean, tués dans l’exercice de leur fonction lors de l’attaque du 24 décembre 2024, n’est qu’un exemple parmi d’autres. Cette insécurité permanente engendre une autocensure de survie, qui rend certains sujets – notamment ceux mettant en cause la collusion entre l’État et les gangs – pratiquement inaccessibles. Ce mécanisme constitue un contrôle indirect mais efficace du récit circulant sur la crise, fragilisant durablement les espaces de contre-pouvoir capables de produire un discours alternatif cohérent.
D’un autre côté, La précarité économique fragilise les rédactions traditionnelles, tandis qu’une prolifération de médias en ligne peu dotés en ressources et souvent dépourvus de formation journalistique rigoureuse brouille les repères professionnels. Dépendantes d’annonceurs privés, de réseaux de clientélisme ou d’efforts individuels, ces structures reproduisent fréquemment des discours officiels sans vérification ni analyse. Communiqués, plans ou declarations, souvent publié sur les réseaux sociaux, deviennent une matière première gratuite et facilement mobilisable. Ce recyclage discursif affaiblit les espaces de production critique, en particulier l’université. L’affaiblissement systématique des lieux de savoir nourrit ainsi un écosystème propice à la circulation du bullshit, où l’État contrôle le discours sans engagement.
Mais ce n’est pas seulement la reprise passive qui contribue à la circulation du bullshit. Le rejet lui-même, lorsqu’il est formulé sur les mêmes canaux – notamment les réseaux sociaux – dans un style mimétique ou ironique, peut en renforcer la visibilité sans toujours en déconstruire le fond. Une publication partagée pour être dénoncée peut susciter des réactions virales tout en prolongeant la vie du message d’origine. Les discussions autour de l’aéroport « international » Antoine Simon des Cayes en sont un exemple. Ainsi, dans un espace médiatique fragmenté, l’indignation et la dérision produisent parfois des effets similaires à l’adhésion, en contribuant paradoxalement à la trivialisation et à la désacralisation des espaces institutionnels, renforçant ainsi la banalisation du discours étatique.
Le gouvernement haïtien a développé ses propres circuits de production d’information, à mesure que les médias traditionnels s’affaiblissent. D’un côté, il alimente un flux continu sur les réseaux sociaux : vidéos policières montées, photographies d’événements officiels, déclarations scénarisées. Ces contenus courts, visuels et percutants sont calibrés pour une consommation rapide et émotionnelle. D’un autre côté, il s’appuie sur des canaux réguliers plus ou moins structurés – tels que les Mardis de la Nation (Primature), les Jeudis des Territoires (CIAT) ou Haïti Courrier Diplomatique (MAEC) – qui visent à occuper l’espace symbolique par la répétition d’énoncés fragmentaires.
Dans ce double dispositif, la parole officielle ne suit ni plan d’action ni logique de responsabilité. Elle fonctionne par surgissements discontinus, en réaction à des événements médiatisés, puis s’efface aussitôt l’attention relâchée. Chaque publication est un geste discursif autonome, sans insertion chronologique ni mémoire institutionnelle. Ce régime discursif ne cherche ni à informer ni à coordonner, mais à être vu. Il privilégie la présence narrative à la gouvernance effective, substituant au gouvernement un théâtre de signes – une forme aboutie de bullshit politique.
Dans cet espace éclaté, le bullshit circule librement. Il tire sa force de la saturation fragmentée du langage public, où chaque énoncé performe un geste de pouvoir – promesse, condamnation, annonce – tout en restant sans suite, sans ancrage, sans suivi. L’État ne produit plus des actions, mais des signes d’action, sans cohérence ni continuité. Ce flux d’énoncés fonctionne comme une projection symbolique de présence, destinée à occuper l’espace public malgré l’effondrement des capacités réelles de gouvernance. Mais cette parole sans effet finit par produire un impact bien réel. À force de se répéter sans entraîner de changement tangible, elle suscite chez les citoyens un sentiment d’incrédulité, d’usure et de détachement, que nous reviendrons analyser plus loin sous les traits d’une désaffiliation politique et d’un scepticisme structurel.
2. Une réception fragmentée : entre saturation, ironie et défiance
La prolifération du bullshit gouvernemental dans l’espace public haïtien ne se fait pas sans résistance. La parole officielle, bien qu’omniprésente, ne l’est pas en raison de sa cohérence ou de sa force persuasive, mais parce que l’État continue de parler – parce qu’il le doit, parce qu’on attend de lui qu’il parle, et parce qu’en contexte de vide institutionnel, même une parole creuse vaut présence symbolique. Cette présence continue prend la forme de déclarations réactives, de publications fragmentées, de rituels administratifs ou de cérémonies scénarisées, souvent sans lien entre elles. Malgré cela, cette parole suscite une réception critique, souvent spontanée, nourrie par une mémoire populaire vive et un scepticisme largement partagé. Cette résistance s’exprime notamment sur les réseaux sociaux, devenus un espace clé de confrontation entre le discours du pouvoir et l’expérience vécue des citoyens.
Les réactions ironiques, les commentaires sarcastiques, les caricatures et les détournements visuels se multiplient à chaque publication officielle. Lorsqu’un communiqué annonce une nouvelle « offensive contre les gangs » ou une « réhabilitation prochaine » d’infrastructure, les internautes rappellent en boucle les promesses non tenues, les délais ignorés, les bilans crédibles jamais publiés. Des phrases comme « Konbyen fwa nou deja tande sa ? » ou « Mwen swete se pa sinema nap fè ankò » traduisent un langage populaire de défiance, qui fissure la crédibilité du discours institutionnel. Cette remise en question s’exprime aussi dans des éditoriaux, des analyses de rapports publics, des tweets, ou encore des publications Facebook et LinkedIn. Mais malgré leur fréquence, ces critiques demeurent fragmentées. Elles prennent la forme d’éruptions ponctuelles, sans structuration collective ni relais institutionnel. Hors des cercles militants, journalistiques ou académiques, leur portée reste limitée. Elles se heurtent à l’absence de données fiables, à la précarité des rédactions et à la faiblesse des espaces de débat. La contestation existe bel et bien, mais elle demeure désarticulée, piégée dans un flux informationnel où il devient difficile de produire un contre-récit durable.
3. Le paradoxe du bullshit dans l’espace public
Ce double mouvement – saturation de la parole officielle et fragmentation de la résistance – produit un paradoxe curieux. Plus le gouvernement parle, plus il est perçu comme déconnecté de la réalité quotidienne vécue par les citoyens. Chaque prise de parole contribue à élargir le fossé entre l’État et la confiance publique. Les condamnations solennelles, les annonces de plans d’action, les déclarations de soutien ou de fermeté s’enchaînent selon une logique répétitive qui vide le langage de son pouvoir d’affectation. La parole étatique devient prévisible, immédiatement sujette à moquerie ou à suspicion. Et pourtant, elle continue de s’énoncer, de se déployer, d’occuper l’espace.
Cette insistance du discours, malgré son effet de rejet, peut être comprise à la lumière du concept de gouvernance performative, tel que formulé par Ding (2022). Lorsque l’État est structurellement incapable de produire des résultats tangibles, il investit la mise en scène comme substitut à l’action. Mais cette performance ne peut fonctionner que si elle réussit à aligner ses éléments – acteurs, scripts, publics – dans une cohérence minimale. Or, comme le souligne Alexander (2011), cet alignement peut échouer : on assiste alors à un processus de défusion, où le public cesse de croire à la sincérité de la performance, brisant ainsi son efficacité symbolique[1].
C’est précisément ce que donne à voir la scène politique et sociale haïtienne : un État qui performe sans convaincre, un langage d’autorité qui ne trouve plus de résonance dans la population. Le pouvoir ne subit pas un effondrement, il refuse activement de jouer son rôle étatique, de s’engager concrètement dans l’exercice des responsabilités attendues de lui. La communication gouvernementale est ainsi une performance automatique, déconnectée de tout espace d’écoute ou de dialogue, réduite à un énoncé rituel.
À ce stade, la parole de l’État ne produit plus d’effets politiques ; elle entre dans le registre du simulacre[2], au sens où l’entend Baudrillard (1981). Elle ne représente plus l’action, ni même la volonté d’agir, mais seulement le signe abstrait d’un pouvoir qui persiste sans substance. Le bullshit constitue, dans ce contexte, le régime discursif de cette souveraineté vacillante : il ne cherche plus à dissimuler l’absence d’action, il la recode symboliquement dans un flux de mots qui mime le gouvernement sans le réaliser.
Ce régime permet paradoxalement à l’État de continuer à exister dans l’espace public – non comme instance de régulation et de protection, mais comme acteur performatif sans performance réussie. Il performe – par ses discours, communiqués, rapports, projets de loi et autres pratiques symboliques – et ce seul déploiement suffit à maintenir, encore un moment, la fiction d’un pouvoir en place.
III. Le bullshit comme dispositif politique : langage de souveraineté sans autorité, droit sans engagement
1. Le bullshit comme infrastructure de la capture étatique
La thèse dominante de l’« État failli » considère qu’Haïti serait entré dans une phase d’effondrement institutionnel, caractérisée par l’absence de gouvernance effective, la perte du monopole de la violence légitime et l’incapacité à fournir les services de base (Rotberg, 2004). Cette perspective, largement mobilisée dans les milieux internationaux, tend à naturaliser la défaillance comme une condition structurelle, justifiant des interventions externes au nom de la reconstruction étatique. D’autres approches critiques, comme celle de Robert Fatton (2002), proposent une lecture différente : loin d’être un État en retrait, Haïti fonctionnerait comme une république prédatrice, où les élites accaparent les ressources publiques dans un système clientéliste de redistribution sans régulation, perpétuant une transition démocratique sans fin.
Plus récemment, Paul (2023) déplace encore le regard : selon lui, la crise n’est pas tant l’effet d’une absence d’État que d’un effondrement des corps de contrôle — police, justice, organes de régulation, presse, institutions professionnelles — qui ne remplissent plus leurs fonctions de veille, de contre-pouvoir et de reddition de comptes. Cette désactivation des mécanismes internes de régulation révèle une crise du Tiers institué (Legendre, 1994), cette instance symbolique qui garantit la stabilité normative et la légitimité de la loi. L’effondrement serait donc interne aux institutions elles-mêmes, et non le simple résultat d’un désengagement fonctionnel.
Mais ces approches partagent un même présupposé : que le problème réside dans l’inefficacité ou la démission des institutions. Or, ce que donne à voir l’analyse du bullshit, c’est tout autre chose : l’ineffectivité est organisée, structurée, et politiquement utile. Le bullshit permet à l’État de produire du langage normatif sans intention d’application, occupant symboliquement la place de la loi, de la politique publique, du contrôle – tout en neutralisant leur effectivité.
L’espace discursif ainsi dégagé se présente comme le terrain d’opération privilégié de la capture clientéliste. L’État n’est pas absent : il produit les formes extérieures de l’action publique – annonces, contrats, plans, discours – tout en suspendant leur mise en œuvre. Le cas emblématique de l’aéroport international des Cayes en témoigne. Financé à hauteur de plus de 26 millions de dollars par le fonds Petrocaribe, le projet a été arrêté sans justification au bout de 17 mois, avec à peine 38 % du budget engagé et une piste partiellement amorcée. Aucune infrastructure fonctionnelle n’a été construite. Dans son rapport d’audit, la CSCCA (2019) souligne l’absence de suivi, de justification de l’arrêt, de pénalités appliquées, et note que la zone est aujourd’hui envahie par la végétation, sans clôture ni bâtiments.
En 2025, ce même site a pourtant été inauguré comme « aéroport international », sans que les travaux payés par les fonds publics aient été relancés. Ce geste sert à recoder l’inachevé comme réalisé, dans une dynamique décrite par Cova (2024), où le bullshit est une affirmation séduisante en surface, mais qui ne résiste à aucune analyse sérieuse. Cette pratique ne constitue pas seulement un simulacre symbolique (Baudrillard, 1981), elle représente également une modalité explicite de corruption institutionnalisée, où l’État détourne des ressources publiques tout en prétendant accomplir ses missions, au détriment direct de la population.
En ce sens, le bullshit ne masque pas un vide institutionnel, il organise une économie discursive structurée autour de la mise en circulation de signes de gouvernance – lois, projets, annonces – qui miment l’autorité tout en suspendant les exigences de transparence, d’effectivité et de responsabilité. Cette dynamique rejoint précisément l’analyse de Greg Beckett (2014), qui applique la thèse de James Scott sur « l’art de ne pas être gouverné » au contexte particulier de Port-au-Prince. Selon Beckett, la marginalisation urbaine dans la capitale haïtienne résulte non pas d’une incapacité étatique, mais d’un choix stratégique délibéré consistant à ne pas intervenir activement dans certaines zones, favorisant ainsi une gouvernance fondée sur l’exclusion et l’abandon institutionnel. Cette « gouvernance par le non-gouvernement » transforme des quartiers entiers en zones d’extrême précarité et de violence chronique, tout en permettant à l’État d’éviter ses responsabilités directes et de préserver paradoxalement son autorité nominale. Elle s’incarne aussi dans des dispositifs juridiques et réglementaires qui participent à cette logique d’inaction structurée. Le Code national du bâtiment, par exemple, ignore sciemment l’ensemble des lois, décrets et procédures existants – parfois contradictoires entre eux – relatifs au permis de construire, au zonage ou à la gestion urbaine. Il fonctionne comme un document fantôme : censé réguler, mais conçu pour n’engager personne, ni les autorités, ni les citoyens.
Ce type de norme flottante, sans opérationalité réelle, institutionnalise une forme de vacuité normative. Les gouvernants ne se sentent pas tenus de faire appliquer ces règles, et les gouvernés ne se sentent pas contraints de les respecter. Lorsque l’autorité invoque la loi, c’est souvent dans un cadre opportuniste – non pour garantir un ordre légal commun, mais comme levier d’intimidation, d’exclusion ou de négociation clientéliste. Ce cadre normatif simulé devient ainsi un instrument de corruption organisée : il permet d’arbitrer à la discrétion, de conditionner l’application de la règle à l’allégeance ou au paiement, et de maintenir un désordre utile à la reproduction du pouvoir.
Ainsi, le régime discursif du bullshit fonctionne comme infrastructure idéologique de cette stratégie : il garantit à l’État une présence symbolique permanente, sans obligation réelle de résultats, tout en rendant la gouvernance insaisissable, opaque et foncièrement déresponsabilisée.
2. Stratégie discursive et désaffiliation politique : neutralisation normative et cynisme social
Dans le régime du bullshit, le langage institutionnel se déploie non pour réguler ou gouverner, mais pour occuper l’espace discursif. L’État continue de produire des normes – lois, décrets, plans, codes – mais celles-ci ne visent plus l’effectivité. Elles sont formulées pour exister symboliquement, comme signes de gouvernance. Ce n’est pas tant l’absence de cadre normatif qui caractérise la crise haïtienne, mais la séparation croissante entre les énoncés et leur application, entre la parole publique et la réalité sociale. Le droit devient spectacle : on le cite, on le diffuse, on le met en scène – mais on ne l’active pas. Ce que Baudrillard (1981) nommait « simulacre » prend ici la forme d’un État mimant ses fonctions à travers des rituels de régularité administrative.
Cette dissociation produit une forme de souveraineté discursive : l’État ne gouverne plus par des politiques, mais par des signaux. Il parle – par notes, conférences, communiqués, codes, nominations – non pour convaincre ou transformer, mais pour maintenir l’illusion d’une présence. Cette parole étatique devient autonome, autoréférentielle, déliée de ses destinataires comme de ses effets. Elle n’attend ni retour, ni vérification, ni obéissance. Elle ne vise plus la légitimité, mais la visibilité.
Mais cette mise en scène permanente a un coût politique. La répétition de promesses sans suite, de déclarations indignées sans conséquences, génère un processus de désaffiliation politique. À force de se heurter à un langage sans action, les citoyens cessent d’y croire. Le scepticisme devient structurel ; la méfiance, ordinaire. Ce phénomène ne se traduit pas nécessairement par une mobilisation, mais par une forme de retrait stratégique. L’ironie, le sarcasme, la dérision sont devenus les modalités les plus courantes de réception du discours étatique. Ce cynisme est une compétence : il permet de lire les codes de la communication gouvernementale comme une grammaire du vide. On n’attend plus la réalisation d’une promesse ; on en déchiffre la fonction symbolique.
Cette défiance historique trouve une expression populaire éloquente dans la chanson Pawòl Tafia de Boukman Eksperyans (1998), qui dénonce la vanité des discours politiques sans lendemain, ou encore Aloral du groupe Brother’s Posse (2013), que Joersz (2015) analyse comme une critique directe des promesses non tenues du gouvernement Martelly, devenue un slogan politique circulant largement dans l’espace public haïtien. Ces productions culturelles ne documentent pas seulement la crise ; elles traduisent, en langage sensible, l’usure lente du lien politique. Le bullshit n’efface pas l’État : il produit un espace dans lequel l’action publique est remplacée par son imitation permanente – et la croyance, par l’endurance sceptique.
Mais le bullshit ne relève pas simplement d’un langage vide ou d’un défaut d’action. Il constitue une infrastructure discursive pleinement intégrée à la stratégie de gouvernement. Il permet à un État capturé, privé de toute capacité régulatrice, de simuler l’autorité publique tout en se soustrayant aux exigences de la responsabilité. Cette parole désancrée ne cherche pas à convaincre ni à organiser ; elle vise à signifier la présence d’un État sans effectivité, adressée autant aux citoyens qu’aux bailleurs, voire à l’appareil étatique lui-même. Il ne s’agit donc pas d’un échec du langage politique, mais de son instrumentalisation réussie au service du pouvoir.
Cette économie discursive du simulacre facilite concrètement la perpétuation de pratiques d’appropriation des ressources publiques, comme en témoignent les récentes propositions constitutionnelles visant à institutionnaliser l’irresponsabilité des dirigeants. Le bullshit devient alors un rouage du système de prédation : il fabrique l’illusion d’un État agissant tout en organisant l’impunité.
Comprendre cette dynamique implique de dépasser l’analyse de la production institutionnelle, pour inclure les circuits de diffusion, de réception et de reproduction du bullshit dans l’espace public – là où s’articulent sa légitimation, sa contestation ou son recyclage stratégique.
Conclusion
L’analyse du bullshit comme régime discursif en Haïti permet de déconstruire l’illusion d’un État failli par défaut ou submersion. Il ne s’agit pas seulement d’un langage vide ou d’un dysfonctionnement de la communication publique. Le bullshit fonctionne comme une infrastructure discursive centrale, qui permet à un État capturé de simuler l’action, de maintenir une présence symbolique, et surtout, d’organiser son désengagement sans jamais le déclarer.
En ce sens, le bullshit n’est ni accidentel ni marginal. Il constitue le socle idéologique qui rend possible la prédation décrite par Fatton (2002), la neutralisation des corps de contrôle analysée par Paul (2023), et l’abdication stratégique de souveraineté suggérée par Beckett (2014). Il soutient un pouvoir sans régulation, sans mémoire, sans responsabilité, qui mime les formes de l’État tout en se retirant de ses fonctions régaliennes. Ce pouvoir ne gouverne plus, mais performe sa présence – même dans la défusion (Alexander, 2011) – par une répétition de gestes langagiers désancrés.
Ce régime discursif autorise une forme de souveraineté sans obligation : il permet de parler sans agir, de promettre sans planifier, d’indigner sans intervenir. Il crée un espace où les lois sont rédigées pour ne pas être appliquées, les plans d’action conçus pour ne rien engager, et les institutions préservées comme décors. L’abdication devient invisible car elle se donne sous les traits d’une parole d’autorité.
C’est à ce nœud stratégique qu’il faut s’attaquer : repolitiser la parole publique, réarticuler la souveraineté à la responsabilité, et briser l’économie du simulacre. Il ne s’agit pas seulement de produire de nouveaux discours, mais de reconstruire les conditions d’une autorité soumise à la loi, à la vérité et à la reddition de comptes. Cela implique un cadre institutionnel contraignant, une réactivation des corps de contrôle, et une culture politique fondée sur la vérifiabilité.
Mais cette refondation ne sera pas seulement juridique ou technique : elle exige un changement de régime discursif. Elle appelle à une parole qui engage – non parce qu’elle promet, mais parce qu’elle est adossée à des mécanismes de responsabilité concrets, reconnus, contraignants. Résister au bullshit, c’est alors redonner à la parole publique sa charge normative, sa gravité politique, sa capacité à structurer le réel et à rendre compte devant la société.
Références
Alexander, J. C. (2011). Performance and power. Polity.
Baudrillard, J. (1981). Simulacres et simulation. Éditions Galilée.
Beckett, G. (2014). The art of not governing Port-au-Prince. Social and Economic Studies, 63(2), 31–57.
Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques. Fayard.
Castoriadis, C. (1996). La montée de l’insignifiance : Les carrefours du labyrinthe IV. Seuil.
Cohen, G. A. (2002). Deeper into Bullshit. In S. Buss & L. Overton (Eds.), The Contours of Agency: Essays on Themes from Harry Frankfurt (pp. 321–339). The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/2143.003.0015
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA). (2019). Audit spécifique de gestion du fonds Petrocaribe, Rapport 1. CSCCA - Cour Supérieure des Comptes et du contentieux administratif.
Cova, F. (2024). What’s wrong with bullshit. Ergo an Open Access Journal of Philosophy, 11(0). https://doi.org/10.3998/ergo.6162
Ding, I. (2022). The performative state. Princeton University Press.
Fatton, R. (2002). Haiti’s predatory republic: The unending transition to democracy. Lynne Rienner.
Foucault, M. (2004). Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France (1977–1978) (F. Ewald, M. Senellart & A. Fontana, Éds.). Seuil/Gallimard.
Gibbons, A. F. (2024). Bullshit in politics pays. Episteme, 21(3), 1002–1022. https://doi.org/10.1017/epi.2023.3
Gligorić, V., Feddes, A., & Doosje, B. (2022). Political bullshit receptivity and its correlates: A cross-country validation of the concept. Journal of Social and Political Psychology, 10(2), 411–429. https://doi.org/10.5964/jspp.6565
Greene, G. (1966). Les Comédiens. Livre de Poche.
Harris, T. R. (2024). The wrong of bullshit. Social Epistemology, 38(4), 413-424. https://doi.org/10.1080/02691728.2023.2267501
Hibbert, F. (1923). Les Simulacres: L’aventure de M. Hellénus Caton. Port-au-Prince: Imprimerie Chéraquit
Joersz, A. C. (2015). Sloganization and the political pragmatics of interdiscursivity: The social life of a haitian political critique. Journal of Linguistic Anthropology, 25(3), 303–321. https://doi.org/10.1111/jola.12105
Paul, B. (2023). L’échec des corps de contrôle comme cause profonde de la crise institutionnelle en Haïti. Études Caribéennes, 56. https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.29343
Petrocelli, J. v., Seta, C. E., & Seta, J. J. (2023). Lies and bullshit: The negative effects of misinformation grow stronger over time. Applied Cognitive Psychology, 37(2), 409–418. https://doi.org/10.1002/acp.4043
Rotberg, R. I. (2004). When states fail: Causes and consequences. Princeton University Press.
[1] Cette hypothèse rappelle celle formulée dans le roman Les Comédiens de Graham Greene (1966), évoquant la dictature en Haïti comme une mise en scène permanente sans authenticité.
[2] Baudrillard définit le simulacre comme la substitution du signe à la réalité elle-même. Ce concept trouve aussi un écho dans le roman haïtien Les Simulacres de Fernand Hibbert (1923), où l’auteur met en scène une société prise au piège de discours et de performances vides de sens, caractérisées par l’opportunisme et l’hypocrisie généralisée.