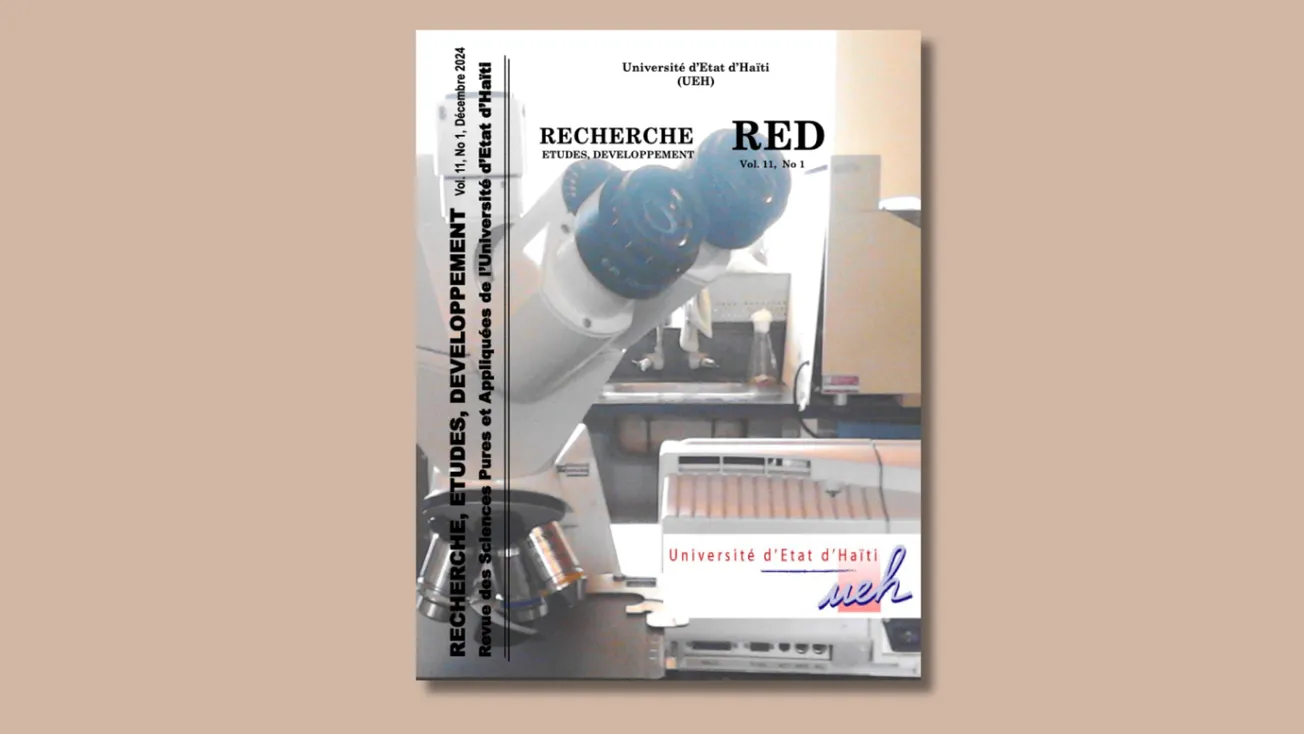Table des matières
Entre le Parti démocrate et le Parti républicain, il n’existe pas de différence de principe. Historiquement, les deux formations ont toujours défendu les intérêts des États-Unis au nom de la Constitution et du peuple américains. Deux piliers fondamentaux d’une démocratie états-unienne qui n’était pourtant pas véritablement démocratique, même lorsque Alexis de Tocqueville en faisait l’éloge dans son ouvrage De la démocratie en Amérique. Ce rappel aurait été utile aux Européens, au moment où J.D. Vance prétendait donner une leçon de démocratie à l’Union européenne. Cela ne nous empêche toutefois pas de questionner l’avenir de la démocratie américaine dans ce contexte mondial de menaces de guerre, de réarmement et d’offensives économiques. Donald Trump serait-il le trompe-l’œil d’une tradition américaine qui ne peut plus simuler la gouvernance démocratique sous le masque du soft power ? Trump apparaît moins comme un accident politique ou une rupture idéologique que comme le révélateur brutal d'une continuité historique, celle d'une démocratie américaine façonnée dès ses origines par une classe dominante anglo-saxonne et conservatrice qui, tout en maintenant l'apparence du pluralisme, gouverne en consolidant ses propres intérêts.
L’idée de tolérance et celle du melting-pot n’ont jamais réellement constitué le fondement idéologique des États-Unis, qui ont toujours défendu les valeurs anglo-saxonnes, enracinées dans un protestantisme réactionnaire, malgré ce que suggèrent les discours de campagne actuels des démocrates. C’est précisément pour cette raison que de nombreux intellectuels issus de la bourgeoisie aristocratique française du XIXe siècle ont longtemps considéré le livre de Tocqueville comme une œuvre exotique, animée de prétentions romantiques à l’égard des Américains de l’époque, ces pionniers des treize États en passe de devenir l’État fédéral que nous connaissons aujourd’hui. Pourtant, les idées d’Alexander Hamilton, de James Madison et de John Jay ont tracé les grandes lignes du système social, politique, économique et militaire des États-Unis contemporains. Elles ont inspiré à la fois le Parti républicain et le Parti démocrate, qui ont contribué à établir et défendre l’hégémonie américaine dans le monde.
Cependant, la question de l’esclavage des Noirs, puis celle de leur intégration dans la démocratie américaine après l’abolition de la servitude dans les États du Sud par Abraham Lincoln, ont exigé que la gouvernance politique de Washington poursuive deux objectifs complémentaires : d’une part, la structuration d’un nationalisme d’existence propre aux États-Unis, avec des intérêts et des différences sociales difficilement conciliables ; d’autre part, l’opérationnalisation de la doctrine du président James Monroe, posant les bases d’un nationalisme de puissance, capable de s’adapter aux mutations d’une Europe conflictuelle, tiraillée entre le partage de l’Afrique et les rivalités intra-continentales, mais qui possédait tous les atouts pour devenir, aux côtés des États-Unis, une force dominante sur la scène mondiale.
Sans avoir mérité les palmes de l’anticolonialisme et de l’antiesclavagisme montant au XIXe siècle dans l’Amérique des nations, l’élite bourgeoise issue de la Révolution de 1789 en France ne souhaitait nullement approuver l’ouvrage de Tocqueville. Elle justifiait son rejet en critiquant l’esclavage des Noirs dans les États du Sud des États-Unis, ainsi que les mœurs qu’elle jugeait « sauvages » de ce pays, dont la culture lui semblait être une bâtardise de celle des anciens colons anglais. Se revendiquant héritière des Lumières, la frange la plus radicale de cette élite pensait que les États-Uniens devaient être « policés » par les esprits raffinés de Versailles, devenu symbole des valeurs républicaines pour les États modernes – et ce, malgré la restauration de l’Empire napoléonien, qui avait contraint le célèbre écrivain Victor Hugo à l’exil.
Cependant, les États-Unis s’inspirèrent plutôt de la culture victorienne pour forger une nation distincte de la nation anglaise, tout en bénéficiant de la révolution intellectuelle et industrielle née en Angleterre. C’est au croisement de cette symbiose entre une pensée créole américaine et des racines anglo-saxonnes que se comprend l’alliance politique, économique, idéologique et militaire entre les deux pays, scellée lors des deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945). Une « sainte alliance » qui fut à l’origine de la victoire de l’Europe contre l’Allemagne nazie, de la conférence de Yalta et du développement des démocraties européennes, portées par le plan Marshall de reconstruction des pays détruits sous les bombardements allemands et par les feux des armes que les Américains fournissaient aux pays de la sainte alliance.
La fin des régimes autoritaires dans une Europe pacifiée après 1945 a engendré une crise de la « culture humaine », pour reprendre les mots d’Hannah Arendt. Cette crise a bouleversé les conceptions nationales et mondiales de la coexistence des peuples et des individus. Elle a imposé aux êtres humains la nécessité de s’accorder sur les définitions fondamentales de l’humanité, du monde, de la liberté, de la démocratie et d’une paix durable. C’est pourquoi le militantisme des intellectuels et des politiques engagés dans l’édification d’un nouvel ordre mondial s’est tourné vers la lutte contre le racisme, provoquant la décolonisation du monde africain, morcelé et asservi par une anthropologie européenne ethnocentrée. Mais ce militantisme a également favorisé un éveil à l’universalité de tous les hommes et de toutes les femmes, contribuant à enrichir les pensées démocratiques des États modernes.
Parmi les figures majeures pour les peuples d’origine africaine, on se souvient des noms de Frantz Fanon et d’Aimé Césaire. Mais il faut aussi évoquer tout particulièrement les États-Unis d’Amérique, qui ont accueilli des migrants juifs, arabes, hindous, latino-américains et européens désillusionnés par les atrocités des deux guerres mondiales, hommes et femmes en quête d’un pays où l’on pouvait encore rêver de liberté et de dignité humaine.
La mort de John Fitzgerald Kennedy peut s’expliquer à la lumière de nouvelles tendances idéologiques qui, à l’époque, suscitaient des mouvements sociaux à travers le monde. Ces courants de pensée rejetaient le traditionalisme social et politique, lequel ne condamnait pas le lynchage des Noirs avant l’abolition de l’esclavage, et fermait les yeux sur l’exclusion et la discrimination dont les Afro-Américains étaient les principales victimes. Ces injustices étaient pourtant justifiées, souvent de manière hypocrite, par des lois votées au Congrès d’un pays se réclamant de la démocratie à la manière de Tocqueville.
Le pasteur noir Martin Luther King lança la grande marche de Montgomery avant de prononcer son célèbre discours I Have a Dream, qui donna une résonance nouvelle à l’expression The American Dream, restée l’un des slogans fondateurs de la démocratie américaine. Une démocratie dont Donald Trump, symbole d’une lignée de migrants européens ayant bénéficié de ce rêve, se présente comme un héritier exemplaire.
Ainsi, la démocratie américaine ne saurait être exclusivement l’œuvre du Parti démocrate, qui n’a pas nécessairement mieux défendu les libertés que le Parti républicain. Rappelons qu’Abraham Lincoln, figure emblématique de l’abolition de l’esclavage, était membre du Parti républicain et accéda à la présidence à la Maison-Blanche après la guerre de Sécession. Cela montre bien que Donald Trump ne peut être considéré comme l’ennemi de la démocratie américaine, historiquement construite par les deux piliers du système politique états-unien.
Alors, de quoi Donald Trump serait-il réellement l’ennemi, pour être ainsi rejeté par ses opposants comme un anti-démocrate ?
Pour répondre de manière sommaire à cette question, il faut d’abord admettre que la puissance des États-Unis, sur le continent américain comme dans le monde, repose historiquement sur la classe des grands fermiers et des pionniers de l’industrie lourde, qui incarnaient la tradition des Américains d’origine anglo-saxonne. Certes, ces acteurs furent responsables de la ségrégation raciale et des discriminations ayant longtemps freiné l’intégration de l’ensemble des populations, mais ils ne purent résister à l’évidence de la nécessité d’une démocratie inclusive, exigée par les dirigeants de la Maison-Blanche et du Congrès à Washington. D’autant plus qu’ils ne pouvaient ignorer les conséquences de la participation des États-Unis aux deux grandes guerres européennes, ni leur rôle décisif dans la reconstruction des pays dévastés par ces conflits.
L’intégration progressive des migrants européens et leur enracinement dans la culture américaine ont également contribué à affaiblir la position des traditionalistes, pourtant toujours dominants dans les secteurs primaire et secondaire de l’économie américaine. Ainsi, lorsqu’on se demande qui détient réellement le pouvoir à Washington, il faut se référer à cette histoire pour comprendre qu’une classe traditionnelle continue de dicter, de contrôler et de surveiller l’orientation de la gouvernance américaine, tant au niveau national qu’international.
C’est pour cela que de nombreux Noirs vivant dans les quartiers suburbains des États-Unis, ainsi que des universitaires contestataires, n’ont jamais cessé de critiquer la politique de l’ancien président Barack Hussein Obama durant ses deux mandats. Selon eux, il aurait servi une tradition américaine peu soucieuse de modifier sa conception de la répartition des richesses, de la stratification sociale ou encore du système politique états-unien. Certes, sous les présidences de Bill Clinton puis d’Obama, les démocrates ont garanti certains droits sociaux aux minorités ethniques, notamment sous l’influence de mouvements civiques venus de l’extérieur. Mais c’est précisément ce que les partisans de Donald Trump – les trumpistes – reprochent aux démocrates : leur manque d’attachement aux valeurs traditionnelles américaines.
Autrement dit, on pourrait affirmer que M. Trump constitue un trompe-l’œil dissimulant les simulacres d’une démocratie américaine qui n’est pas l’apanage exclusif du Parti démocrate. Il serait, en quelque sorte, l’« œillet » d’une démocratie qui continue de jouer en faveur des intérêts des traditionalistes américains, lesquels, bien qu’ils s’adaptent aux mutations internes et externes du pays, refusent de les initier ou de les anticiper.
Pour conclure, il importe de se rappeler que la guerre menée par le président Donald Trump n’est pas le caprice d’un homme fantasque, aisément destituable par une procédure d’impeachment prévue par la Constitution américaine. M. Trump apparaît plutôt comme un écran de fumée masquant les véritables acteurs : les groupes sociaux formant la classe dominante traditionnelle des États-Unis, qui ont développé une culture leur permettant de s’adapter aux innovations culturelles de la modernité technologique mondiale. On l’a bien vu avec le rap, né comme une culture de protestation avant d’être intégré dans la mode dominante.
En somme, il ne s’agit pas d’un ennemi de la démocratie américaine créant ses propres fronts de guerre personnels, mais d’un descendant de migrants allemands ayant compris les ressorts de la société et de la citoyenneté américaines. Il s’en est fait un défenseur acharné, grâce à une éducation et une politique institutionnelle qui donnent à chacun le sentiment d’appartenir à l’âme même de cette nation.